There’s plenty of time lapse projects documenting the passage of time and the process of aging with human portraits, but how about with animals? This video going viral on the Interwebs right now was creating by making a photo a day of Dunder, a German Shepherd, and shows him growing from an 8 week old puppy to a 1 year old adult. If you have a pet, this concept could be a fun project for getting it involved in your photography!
Time Lapse of a German Shepard from Puppy to Adult
↧
↧
Time-Lapse of Daily Photos from the First 21 Years of a Young Man’s Life
Having over 7,500 photographs flash across the screen in around 360 seconds results in a much faster “photo rate” than Kalina’s video, and the fact that the photographs aren’t uniform in their framing and compositions doesn’t help either. You should probably stay away from the video if you’re at all bothered by rapidly flashing images.
Aside from that, this is an extremely impressive project that required a mind-boggling amount of dedication. If you’re having trouble staying motivated on a daily basis, imagine taking (and sitting for) a photo every single day for 21 years (granted, there are some missing photos replaced with drawings, but those are few and far between).
P.S. Here’s an interesting tip left as a comment on the YouTube video: “To see individual frames much clearer, blink your eyes rapidly.”
↧
Time of my Life
↧
Slow Motion
↧
Génération Y : des corps étrangers pour les entreprises
Les jeunes de moins de 30 ans débarquent dans le monde du travail avec des codes et des motivations bien différents de ceux de leurs aînés.
Par Pauline JacotÀ la une du Point.fr

Certains disent qu'elle n'existe pas. D'autres, au contraire, en font des études, des théories, et même des livres. Dans les deux cas, la génération Y fait parler d'elle, jusque dans les salles de réunion des entreprises françaises, en soulevant cette interrogation : comment intégrer les jeunes de moins de 30 ans au monde de l'entreprise, avec ses codes, ses valeurs et ses exigences ? Que l'on prénomme cette génération "Y" ou non, la question agite les dirigeants, les recruteurs et les salariés, plus âgés que ces représentants de la génération Google, nés entre le milieu des années 1980 et 1995.
Rapport décomplexé à l'autorité
Ce n'est pas simplement l'arrivée d'une nouvelle génération sur le marché du travail, selon Julien Pouget, auteur du livre Intégrer et manager la génération Y aux éditions Vuibert, c'est l'arrivée "pour la première fois de jeunes avec des attentes exprimées et qui veulent satisfaire ces attentes". Moins dociles que leurs aînés, ils ont un rapport plus décomplexé à l'autorité. "Ils ne vont pas vous respecter pour votre titre, mais pour vos compétences", souligne Julien Pouget. Ce nouveau rapport à la hiérarchie déstabilise certains dirigeants : certains vont sentir leur autorité bafouée, d'autres ne vont pas savoir comment réagir face à la quantité de questions d'une génération qui cherche du sens à son travail, habituée à trouver des réponses à chaque instruction reçue. L'art de faire le lien entre ces générations dans le monde du travail est ce que l'on appelle le "management intergénérationnel", une compétence de plus en plus recherchée par les entreprises françaises.Écouteurs, musique et SMS
Les Y sont décrits comme une génération qui bouleverse les codes : ils posent la question des congés et des RTT dès l'entretien d'embauche, ils travaillent en écoutant de la musique et en envoyant des SMS, ils demandent des évolutions de poste au bout de six mois, un an. "Qu'est-ce que vous recherchez ?" demande l'employeur, "Qu'avez-vous à me proposer ?" répond le "Yer". Mais tout n'est pas une question de désir et de développement personnel, il y a aussi un contexte : une société où le chômage touche 25 % des jeunes."Je me méfie des généralités faites sur la génération Y", signale Nathalie Dey, directrice d'une agence Adecco qui recrute des jeunes en intérim, en CDD ou en CDI, "beaucoup de jeunes de moins de 30 ans ont avant tout envie de travailler". "Être jeune n'est pas une faute !" affirme la directrice, qui admet cependant que beaucoup d'entreprises veulent recruter des jeunes qui connaissent déjà les codes de l'entreprise : être présent, arriver à l'heure, respecter la hiérarchie et les consignes données. Comme si, effectivement, ces prérequis n'étaient pas tout à fait naturels.
En tant que génération mondialisée, habituée aux voyages, hyper-connectée, les "Yers" sont avant tout un atout dans les entreprises. "Moi, je les appelle les empêcheurs de tourner en rond", clame Julien Pouget. "Réfléchir sur la manière d'inclure cette génération Y dans l'entreprise est une manière aussi de réfléchir sur les désirs de ses clients ou de ses futurs clients, c'est avant tout une démarche salutaire pour les entreprises !" Salutaire certainement aussi pour la société française qui laisse une place à sa jeunesse très étriquée au risque de devoir faire face à un exil massif de ses jeunes diplômés : 27 % d'entre eux veulent quitter la France en 2013.
↧
↧
L'impuissance de la puissance
Bertrand Badie, né le 14 mai 1950à Paris, est un politologuefrançais spécialiste des relations internationales. Il est professeur des Universitésà l’Institut d’études politiques de Paris et enseignant-chercheur associé au Centre d’études et de recherches internationales (CERI).
Il devient en octobre 1990professeur des Universitésà l’Institut d'études politiques de Paris, et en octobre 1999 directeur du Cycle supérieur de relations internationales de l’IEP de Paris, transformé en septembre 2004 en mention « Relations internationales » du master recherche. Il a été de 1994à 2003 directeur des Presses de Sciences Po.
Il est également depuis février 2002 directeur du Centre Rotary d’études internationales sur la paix et la résolution des conflits, et depuis 2003 membre du Conseil de l’Association française de science politique et du Comité exécutif de l’Association internationale de science politique.
La fin des territoires. La référence des relations internationales qu'est le territoire est en train de disparaître suite à trois changements : la mondialisation, la fin de la Guerre froide et de la bipolarité qui se fondait sur les territoires, et la crise des États (financement, indépendances des banques centrales, fin de l'État providence). On observe ainsi la multiplication des espaces où l'État n'intervient plus et où son contrôle disparaît (guerres civiles (comme en Somalie), "cités", zones démilitarisés (comme en Colombie)). L'État, en outre, est concurrencé par d'autres organisations non-étatiques (ONG, multinationales) dont Badie estime que les décisions influent fortement sur les relations internationales.
L'État importé montre comment la vision de l'ordre territorial a été imposée comme une vision de l'État notamment lors de la décolonisation.
Le retournement du mondeécrit avec Marie-Claude Smouts. Il constate que les identités sont de plus en plus culturelles et de moins en moins universelles, que les relations transnationales sont un mode particulier d'inscription dans l'espace et que les relations sont construites en dehors des espaces nationaux et de leur prise en compte. Mais c’est aussi la négation progressive de la capacité de contrôle de l’État et de sa légitimité. Ainsi on observe la multiplication des espaces de références (Église, mafias, allégeances subnationales), qui conduisent à remettre en cause l’allégeance à l’État.
Lorsque l'on parle des États-Unis, les superlatifs ne manquent pas. Du temps de la guerre froide, c'était une « superpuissance ». Ce serait aujourd'hui une « hyperpuissance », cumulant une hégémonie militaire, économique et culturelle. Bertrand Badie ne nie pas cette prééminence, ni son caractère inédit : pour la première fois le monde vit avec un Léviathan capable de s'imposer militairement face à tout autre Etat. Pourtant, selon le politologue, cette puissance est vaine. Car nous ne vivons plus - y avons-nous vécu un jour ? - dans un monde hobbesien fait d'affrontements d'Etat à Etat, réglés selon le rapport de force militaire des belligérants. Cette vision a pu coller à l'époque de la guerre froide où chacune des superpuissances s'assurait l'allégeance d'une moitié du monde en le protégeant contre son rival. Mais déjà, selon B. Badie, pointait « l'impuissance de la puissance ». Les Etats-Unis comme l'URSS peinaient à contrôler certains conflits périphériques, qui leur revenaient parfois en pleine face : les uns eurent droit au Viêtnam, l'autre à l'Afghanistan. Le constat vaut aujourd'hui encore plus qu'hier. Bien que vainqueurs de la guerre froide, les Etats-Unis ont rapidement perdu de leur attrait. Sans l'ennemi soviétique, les allégeances n'ont plus l'évidence d'hier et les initiatives américaines souffrent d'un déficit de légitimité. La seconde guerre de l'Irak l'illustre. Surtout, si l'armée américaine a pu en 2003 renverser le régime irakien, elle se révèle impuissante à endiguer la violence sociale qui prévaut dans le pays. Face à la puissance militaire se dressent des acteurs, étatiques ou non, qui développent des « stratégies du pauvre » : actions de contestation ou de nuisance, parfois terroristes, que le fort ne peut éteindre. L'analyse de B. Badie aide à penser dans un même mouvement les tentations de la puissance - Etats-Unis en Irak, France en Côte-d'Ivoire - et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Et à mieux comprendre pourquoi les victoires d'aujourd'hui sont parfois les défaites de demain. Ce qui conduit l'auteur à considérer que le multilatéralisme constitue, pour le puissant aussi, la seule stratégie sensée dans un monde interdépendant.
![]()
La puissance n'est plus ce qu'elle était. La fin de la bipolarité, les échecs du développement, la prolifération de formes nouvelles et disséminées de violence ont eu raison des certitudes de naguère. Les armées les plus modernes ou les plus sophistiquées échouent devant les actes de terreur les plus élémentaires ; à mesure qu'elles s'affirment, les dominations essuient davantage de contestation qu'elles ne recueillent d'adhésion ; quant aux menaces les plus diverses, elles échappent à tout espoir de contrôle. Les Etats-Unis sont au centre du paradoxe : jamais un Etat n'a, dans l'Histoire, accumulé autant de ressources de puissance ; jamais pourtant il ne s'est révélé aussi peu capable de maîtriser les enjeux auxquels il doit faire face. La puissance ne peut plus se régaler aujourd'hui des effets revigorants du gladiateur ennemi qui fait face avec le même poids et les mêmes recettes. Privés d'ennemi qui leur ressemblent et qui leur opposent une puissance crédible, les Etats-Unis doivent aujourd'hui affronter une nuisance qui change l'équation du jeu international, tout en étant redoutable et extrêmement difficile à combattre. Derrière ces bouleversements stratégiques se cachent non seulement la fin des guerres d'autrefois, des formes nouvelles de violence et de conflit, mais surtout l'ouverture de la scène internationale aux individus et aux sociétés, c'est-à-dire à l'Autre, celui qu'on connaît mal ou qu'on choisit d'ignorer, qu'on accable d'humiliations faute de pouvoir le forger à son image. En bref, l'ignorance du monde post-bipolaire alimente ainsi de nouvelles violences et crée de nombreux dangers dont seul le multilatéralisme saura nous protéger.
http://www.erudit.org/revue/ps/2006/v25/n2-3/015940ar.pdf
L’impuissance de la puissance
Bertrand Badie - Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 2004, 294 p.
- 1971 : Diplôme (lauréat) de l’Institut d’études politiques de Paris
- 1972 : Licence en droit, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
- 1973 : Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de science politique, IEP de Paris
- 1975 : Doctorat d’État en science politique, IEP de Paris
- 1975 : Diplôme de l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
- 1977 : Diplôme d’études approfondies (DEA) en histoire du XXe siècle, IEP de Paris
- 1982 : Agrégation de science politique
Il devient en octobre 1990professeur des Universitésà l’Institut d'études politiques de Paris, et en octobre 1999 directeur du Cycle supérieur de relations internationales de l’IEP de Paris, transformé en septembre 2004 en mention « Relations internationales » du master recherche. Il a été de 1994à 2003 directeur des Presses de Sciences Po.
Il est également depuis février 2002 directeur du Centre Rotary d’études internationales sur la paix et la résolution des conflits, et depuis 2003 membre du Conseil de l’Association française de science politique et du Comité exécutif de l’Association internationale de science politique.
La fin des territoires. La référence des relations internationales qu'est le territoire est en train de disparaître suite à trois changements : la mondialisation, la fin de la Guerre froide et de la bipolarité qui se fondait sur les territoires, et la crise des États (financement, indépendances des banques centrales, fin de l'État providence). On observe ainsi la multiplication des espaces où l'État n'intervient plus et où son contrôle disparaît (guerres civiles (comme en Somalie), "cités", zones démilitarisés (comme en Colombie)). L'État, en outre, est concurrencé par d'autres organisations non-étatiques (ONG, multinationales) dont Badie estime que les décisions influent fortement sur les relations internationales.
L'État importé montre comment la vision de l'ordre territorial a été imposée comme une vision de l'État notamment lors de la décolonisation.
Le retournement du mondeécrit avec Marie-Claude Smouts. Il constate que les identités sont de plus en plus culturelles et de moins en moins universelles, que les relations transnationales sont un mode particulier d'inscription dans l'espace et que les relations sont construites en dehors des espaces nationaux et de leur prise en compte. Mais c’est aussi la négation progressive de la capacité de contrôle de l’État et de sa légitimité. Ainsi on observe la multiplication des espaces de références (Église, mafias, allégeances subnationales), qui conduisent à remettre en cause l’allégeance à l’État.
Bertrand Badie
Bertrand Badie en 2012
| Naissance | 14 mai 1950 Paris (France) |
|---|---|
| Profession | Professeur des Universités |
| Formation | Science politique (doctorat) |
Lorsque l'on parle des États-Unis, les superlatifs ne manquent pas. Du temps de la guerre froide, c'était une « superpuissance ». Ce serait aujourd'hui une « hyperpuissance », cumulant une hégémonie militaire, économique et culturelle. Bertrand Badie ne nie pas cette prééminence, ni son caractère inédit : pour la première fois le monde vit avec un Léviathan capable de s'imposer militairement face à tout autre Etat. Pourtant, selon le politologue, cette puissance est vaine. Car nous ne vivons plus - y avons-nous vécu un jour ? - dans un monde hobbesien fait d'affrontements d'Etat à Etat, réglés selon le rapport de force militaire des belligérants. Cette vision a pu coller à l'époque de la guerre froide où chacune des superpuissances s'assurait l'allégeance d'une moitié du monde en le protégeant contre son rival. Mais déjà, selon B. Badie, pointait « l'impuissance de la puissance ». Les Etats-Unis comme l'URSS peinaient à contrôler certains conflits périphériques, qui leur revenaient parfois en pleine face : les uns eurent droit au Viêtnam, l'autre à l'Afghanistan. Le constat vaut aujourd'hui encore plus qu'hier. Bien que vainqueurs de la guerre froide, les Etats-Unis ont rapidement perdu de leur attrait. Sans l'ennemi soviétique, les allégeances n'ont plus l'évidence d'hier et les initiatives américaines souffrent d'un déficit de légitimité. La seconde guerre de l'Irak l'illustre. Surtout, si l'armée américaine a pu en 2003 renverser le régime irakien, elle se révèle impuissante à endiguer la violence sociale qui prévaut dans le pays. Face à la puissance militaire se dressent des acteurs, étatiques ou non, qui développent des « stratégies du pauvre » : actions de contestation ou de nuisance, parfois terroristes, que le fort ne peut éteindre. L'analyse de B. Badie aide à penser dans un même mouvement les tentations de la puissance - Etats-Unis en Irak, France en Côte-d'Ivoire - et les obstacles qui se dressent sur son chemin. Et à mieux comprendre pourquoi les victoires d'aujourd'hui sont parfois les défaites de demain. Ce qui conduit l'auteur à considérer que le multilatéralisme constitue, pour le puissant aussi, la seule stratégie sensée dans un monde interdépendant.

La puissance n'est plus ce qu'elle était. La fin de la bipolarité, les échecs du développement, la prolifération de formes nouvelles et disséminées de violence ont eu raison des certitudes de naguère. Les armées les plus modernes ou les plus sophistiquées échouent devant les actes de terreur les plus élémentaires ; à mesure qu'elles s'affirment, les dominations essuient davantage de contestation qu'elles ne recueillent d'adhésion ; quant aux menaces les plus diverses, elles échappent à tout espoir de contrôle. Les Etats-Unis sont au centre du paradoxe : jamais un Etat n'a, dans l'Histoire, accumulé autant de ressources de puissance ; jamais pourtant il ne s'est révélé aussi peu capable de maîtriser les enjeux auxquels il doit faire face. La puissance ne peut plus se régaler aujourd'hui des effets revigorants du gladiateur ennemi qui fait face avec le même poids et les mêmes recettes. Privés d'ennemi qui leur ressemblent et qui leur opposent une puissance crédible, les Etats-Unis doivent aujourd'hui affronter une nuisance qui change l'équation du jeu international, tout en étant redoutable et extrêmement difficile à combattre. Derrière ces bouleversements stratégiques se cachent non seulement la fin des guerres d'autrefois, des formes nouvelles de violence et de conflit, mais surtout l'ouverture de la scène internationale aux individus et aux sociétés, c'est-à-dire à l'Autre, celui qu'on connaît mal ou qu'on choisit d'ignorer, qu'on accable d'humiliations faute de pouvoir le forger à son image. En bref, l'ignorance du monde post-bipolaire alimente ainsi de nouvelles violences et crée de nombreux dangers dont seul le multilatéralisme saura nous protéger.
http://www.erudit.org/revue/ps/2006/v25/n2-3/015940ar.pdf
L’impuissance de la puissance
Bertrand Badie - Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 2004, 294 p.
Les relations internationales contemporaines ne s’expliquent plus désormais par la théorie du gladiateur de Thomas Hobbes. La fin de l’ordre bipolaire a assisté à la remise en cause de l’État comme pivot des relations internationales et dévoilé les apories de la puissance. La crise irakienne en a d’ailleurs révélé les impasses et le paradoxe : la puissance d’aujourd’hui se mesure à la capacité de concevoir les enjeux, d’obtenir des résultats. Or les États-Unis, Léviathan de l’échiquier international, ont la plus grande difficulté à faire face aux nouveaux défis. Ce réservoir de puissance subit en outre une contestation des plus farouches à son égard. Car la puissance aujourd’hui a perdu toute son aura et ceux qui la détiennent deviennent la cible des protest politics et attisent les réactions violentes de la part de ceux qui en sont dépourvus.
Professeur des Universités à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, auteur de La diplomatie des droits de l’homme : entre éthique et volonté de puissance (Paris, Fayard, 2002), Bertrand Badie analyse dans son dernier ouvrage la perte de pertinence du concept de puissance dans le système international post-guerre froide et l’illusion qui consiste à tenter de préserver cette dernière à tout prix.
Ainsi, selon l’auteur, privés d’adversaire à leur mesure, les États-Unis ont cru pouvoir inventer de nouveaux ennemis et prolonger un ordre international qui consacrait leur primauté. Ils se sont heurtés à l’émergence d’une nouvelle violence sociale internationale, nourrie de l’exclusion, de la privation et de l’anomie et contre laquelle les outils traditionnels de puissance sont inopérants. Tandis que le géant cherchait à ramener la puissance sur la scène des États, tout en s’affranchissant des alliances contraignantes, les puissances moyennes et un long cortège d’États « en panne », issus notamment de la prolifération étatique qui a marqué la fin de la guerre froide, se sont détachés de la logique clientéliste qui caractérisait l’ordre bipolaire pour opposer à cette coûteuse relation hiérarchique soit une alternative multilatérale, soit une dynamique de violence asymétrique.
Le manque de vision ou de lucidité du gladiateur n’est pas sans conséquences pour le système international. Car si la violence était autrefois d’extraction essentiellement politique, concernait les États, et se résolvait sur le champ de bataille, celle qui caractérise ce nouveau siècle est désormais sociale, transnationale, et peu maîtrisable. Disséminée, fugace, elle prend la forme du terrorisme, de la guerre civile, s’alimente de la création de marchés de puissance parallèles (nouveaux réseaux mafieux, entreprises terroristes, etc.) et ne vise plus, fait inédit, une destruction du gladiateur qu’elle sait irréalisable, mais la capacité de nuisance qui viendra le déstabiliser.
B. Badie explique donc que ce jeu dangereux prive l’Hegemon de sa latitude à fixer l’ordre du jour de la scène internationale et de sa capacité d’attraction (soft power) puisque ce qui fait sa force devient désormais sa faiblesse. Les pièges de l’unipolarité se referment sur un État qui, en quête d’indépendance et de leadership a misé sur la relance du power politics à l’heure où la logique de puissance tendait à s’inverser.
Dans ce « contexte de solitude », comme le montre avec beaucoup de pertinence B. Badie, il ne reste que deux options aux États-gladiateurs de T. Hobbes : camper sur leurs positions et attendre l’épuisement de leur puissance face au renchérissement de l’unilatéralisme, ou accepter l’interdépendance et adhérer au « bel avenir du multilatéralisme » appelé de ses vœux par une opinion publique internationale (OPI) en construction.
La puissance n'est jamais établie et les cycles de sa métamorphose incessante se succèdent rapidement. A la Maison Blanche, depuis le lendemain de la Seconde Guerre, il y eut tour à tour la présidence impériale, la présidence en péril, la présidence immodérée. Serions-nous aujourd'hui devant une présidence empêchée?
![]()
Les Etats-Unis vivent actuellement un moment-clé. Ils ne peuvent pas ne pas prendre une décision. Le débat est vif. Il s'organise encore autour des vieillles figures américaines traditionnelles : d'un côté les isolationnistes, de l'autre les universalistes. Bref les Etats-Unis, loin de se vivre comme déclinants, se retrouvent tels qu'en eux-mêmes.
Cependant toute initiative leur est devenue plus difficile à prendre. Depuis la fin de la guerre froide, le monde ne s'est pas organisé selon un nouvel ordre qui soit lisible. La puissance américaine est toujours persuadée d'y avoir une destinée manifeste mais elle ne sait plus précisément quelles pistes suivre: elle est, comme peuvent l'être les chiens à la chasse, prise en défaut...

Le Président des États-Unis Barack Obama réfléchit durant une réunion budgetaire dans la chambre
Roosevelt le 27 avril 2009
© The Official White House Photostream - 2013 / Pete Souza
Cependant toute initiative leur est devenue plus difficile à prendre. Depuis la fin de la guerre froide, le monde ne s'est pas organisé selon un nouvel ordre qui soit lisible. La puissance américaine est toujours persuadée d'y avoir une destinée manifeste mais elle ne sait plus précisément quelles pistes suivre: elle est, comme peuvent l'être les chiens à la chasse, prise en défaut...
↧
Industrie: La stratégie du gouvernement tient-elle la route?
INDUSTRIE – «20 Minutes» revient sur les 34 plans présentés ce jeudi...
Des avions électriques, des voitures en pilotage automatique, des tours de bureaux en ossature bois, des robots qui enseignent ou des textiles qui soignent… Jeudi, François Hollande a présenté l’industrie française de demain, qui sera bâtie dès aujourd’hui à travers 34 plans de bataille.Ces secteurs dans lesquels l’Etat dit vouloir mettre le paquet ont été sélectionnés en fonction des savoir-faire déjà présents dans l’Hexagone et jugés capables de séduire le monde. Pour autant, et comme le précise François Hollande, «il ne s’agit pas de revenir aux grands plans des années 1960 et 1970 (Concorde, TGV, Ariane, nucléaire, etc. ndlr) où l’Etat était l’inventeur, le prescripteur, le producteur et le client final», mais «de donner un cadre et d’accompagner» cette nouvelle industrie.
«Il faut bousculer ce qui existe déjà»
Concrètement, chacun des 34 plans sera animé par un chef de projet issu du monde industriel, qui pilotera l’ensemble et fera remonter les difficultés et les besoins. Les programmes devront aboutir dans dix ans maximum et tous les six mois, le Premier ministre les passera en revue. Côté finances, le chef de l’Etat a annoncé un soutien de 3,5 milliards d’euros, qui seront pris sur le budget des investissements d’avenir (12 milliards prévus), et viendront s'ajouter aux investissements des industriels.
Philippe Waechter, directeur des études économiques de Natixis Asset Management, s’interroge sur les fonds alloués: «Pour que ces nouvelles industries puissent se développer, il faut mettre les moyens et bousculer ce qui existe déjà. Notamment en transférant les ressources des secteurs fragiles à ceux jugés prometteurs… Ce que nous avons beaucoup de mal à faire en France. Tant que le gouvernement n’explique pas clairement comment il compte faciliter cette bousculade, sa stratégie ne peut être suffisante».
Des emplois en quantité limitée
Quant au Medef, s’il salue cette initiative, il appelle le gouvernement à «enclencher rapidement une baisse du coût du travail et des charges pesant sur les entreprises afin de maximiser la création d'emplois qui pourra découler de cette ambition». En termes d’emplois d’ailleurs, les chiffres avancés par le gouvernement sont loin de faire rêver.
D’aprèsle cabinet McKinsey, ces 34 plans pourraient, dans les dix ans qui viennent, conforter et créer 480.000 emplois… Alors que la France a perdu 750.000 emplois industriels ces dix dernières années. «Penser que l’industrie moderne va créer de nombreux emplois est un fantasme. Elle générera des gains, mais peu de postes. Il faut d’ailleurs se poser dès à présent la question de la répartition de cette future richesse, puisqu’elle ne sera redistribuée qu’à très peu de salariés», avertit Philippe Waechter.
La France lance 34 plans de reconquête industrielle
 Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, le 11 septembre 2013 à l'Elysée, à Paris Patrick Kovarik
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, le 11 septembre 2013 à l'Elysée, à Paris Patrick Kovarik ECONOMIE - Ils sont présentés ce jeudi à l'Elysée par le président de la République François Hollande, avec le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg...
Le gouvernement dévoile jeudi 34 plans de «reconquête industrielle» pour préparer au défi de la compétition mondiale ses filières les plus prometteuses, autour du TGV et des voitures du futur, de textiles innovants, de biocarburants, et autres objets connectés.Trois axes stratégiques
Ces plans d'action expriment la «Nouvelle France industrielle», A travers ce programme, la France, forte d'une tradition d'ingénieurs et d'inventeurs, mais dont l'industrie a décliné depuis des années, veut retrouver une place majeure dans les grands pays industriels à horizon de 10 ans et conquérir des positions fortes en créant les objets du futur.«Ces 34 plans ont pour but de nous repositionner dans la mondialisation et de nous rendre plus forts, en mettant beaucoup de moyens: nos ressources technologiques, industrielles, économiques, humaines, financières», a expliqué Arnaud Montebourgà l'AFP.
Trois grand axes stratégiques seront définis par le président de la République: la transition énergétique et environnementale, la santé et le numérique. Les plans doivent permettre à terme d'augmenter la part de l'industrie dans le produit intérieur brut français et les emplois.
L'ensemble est le fruit d'une analyse d'un an au sein du ministère du Redressement productif, avec le concours du cabinet McKinsey, qui a aidé «à concentrer les forces sur les points forts, les atouts» de l'industrie française.
Une renaissance
«Notre socle est très rétréci, mais très solide. C'est une base pour redémarrer et partir à la conquête de marchés nouveaux» et «recommencer à faire croître nos parts de marchés», a souligné le ministre qui appelle à «une renaissance» de l'industrie.«Les changements de mode de vie vont avoir des conséquences industrielles, en termes de produits et de créations d'emplois, si nous les exploitons», estime-t-il.
Selon les estimations du cabinet McKinsey, les 34 plans industriels pourraient se traduire en dix ans par près de 480.000 emplois industriels soit créés soit renforcés là où ils étaient menacés. Le projet pourrait dégager 45 milliards d'euros de valeur ajoutée au bout de dix ans et 18 milliards d'euros d'exportation en plus.
Une estimation jugée «réaliste, mais très volontaire» par Arnaud Montebourg, qui a placé le made in France au coeur de son action.
Le ministre a lancé en début d'année une nouvelle stratégie de filières industrielles avec l'objectif à la fois de consolider les industries existantes et d'investir dans des technologies clé pour le long terme en visant des innovations de rupture. La définition des 34 plans industriels s'inscrit dans cette philosophie.
Quelque 80% de ces «plans de reconquête industrielle» sont des projets issus des filières et l'Etat a pris «la décision de les porter, de les réunir, de les ordonner et de les financer», a souligné le ministre du Redressement productif.
Certains des projets étaient déjà lancés au sein des filières comme la voiture consommant 2 litres aux 100 km ou le «TGV du futur». Les 34 plans couvrent un vaste éventail de secteurs: transports (véhicule sans pilote, avion électrique), textile, bois, chimie verte, réseaux électriques, numérique, robotique, biotechnologies médicales, nano-électronique, objets connectés, etc.
La «grande innovation» revendiquée de la Nouvelle France industrielle est que les chefs de projets chargés de la mise en oeuvre seront en très grande majorité des industriels, «chefs d'orchestre» des projets. Ils devront constituer les équipes et bâtir des coopérations entre public et privé.
L'État interviendra à travers la législation, les moyens fiscaux, les commandes, mais aussi avec des financements publics comme le Plan d'investissements d'avenir. Au total, 3,7 milliards d'euros d'argent public pourraient être consacrés aux plans, avec l'objectif que l'investissement privé prenne le relais à un niveau supérieur.
↧
8 Year-Old Yemeni Child Bride Dies of Internal Injuries
An 8 year-old Yemeni child bride, a mere girl, recently died on her wedding night from internal hemorrhaging. She was married to a man five times her age. As disgusting as the tradition of marrying off children to much older men is, it is common practice in Yemen. More than a quarter of the female population are married before the age of 15.
In 2010, a 12 year-old girl passed away after struggling for three days in labor, attempting to give birth to a baby. Countless other children have been subjected to similar atrocities.
Groups all over the world are working to snuff out this archaic and disgusting practice, but its proving difficult. The impoverished country is gripped by the practice of selling off children to be married; poor families find themselves unable to say no to “bride-prices” that can be hundreds of dollars for their daughters.
More people need to know this is happening. Hit the SHARE icon below to spread the word.
In 2010, a 12 year-old girl passed away after struggling for three days in labor, attempting to give birth to a baby. Countless other children have been subjected to similar atrocities.
- At only 8 years-old, one child bride in Yemen sustained internal injuries so severe, she died.
- Marrying young daughters to much older men is a common practice in Yemen.
- More than a quarter or Yemen’s female population marry before the age of 15.
- These atrocities against young girls have outraged groups all over the world who are working to stop this barbaric tradition.
More people need to know this is happening. Hit the SHARE icon below to spread the word.
↧
Le harcèlement moral dans le milieu professionnel : la peur au ventre
 Alors que certains salariés reprennent le travail, le cœur léger bien qu’avec un peu de nostalgie due à la fin des vacances, pour d’autres, la reprise est synonyme de souffrance et c’est la peur au ventre qu’ils prennent le chemin du bureau. Si les risques psychosociaux revêtent de nombreux visages (stress au travail, violence, mal-être, burn-out, harcèlement sexuel) il y a une souffrance qui fait des ravages en silence : le harcèlement moral.
Alors que certains salariés reprennent le travail, le cœur léger bien qu’avec un peu de nostalgie due à la fin des vacances, pour d’autres, la reprise est synonyme de souffrance et c’est la peur au ventre qu’ils prennent le chemin du bureau. Si les risques psychosociaux revêtent de nombreux visages (stress au travail, violence, mal-être, burn-out, harcèlement sexuel) il y a une souffrance qui fait des ravages en silence : le harcèlement moral.Une vraie problématique
Des études françaises indiquent que 9 à 10% des salariés ont déjà subi des situations de harcèlement moral sur leur lieu de travail avec une durée moyenne de harcèlement d’un peu plus de 3 ans. Il faut noter de grandesdifférences entre les secteurs d’activités. Dans le privé,le harcèlement moral est violent et dure moins longtemps car le salarié finit par démissionner. Dans le secteur public, de par la sécurité de l’emploi, le mode d’organisation très hiérarchique et l’inertie du système, le harceleur peut sévir pendant très longtemps (parfois plus de 10 ans) de manière très pernicieuse. Les victimes, ne pouvant changer de poste ou démissionner, vivent au quotidien dans une grande solitude avec à terme, des conséquences dramatiques sur leur santé mais aussi sur leur personnalité.Une violence invisible et répétitive
Selon la psychanalyste, Marie- France HIRIGOYEN, la référence Française dans ce domaine et l’auteur de plusieurs livres sur cette thématique, le harcèlement moral au travail se définit « comme une conduite abusive (geste, parole, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne, mettant en péril son emploi ou dégradant le climat de travail»C’est donc une violence invisible et sourde qui se caractérise par des attaques régulières faites par petites touches qui ont pour intention la domination, l’isolement et l’anéantissement de l’autre. Chacune des attaques prise séparément n’est pas très significative, elle est même parfois tellement perverse et sophistiquée qu’il est difficile de la repérer mais c’est surtout le caractère répétitif qui en fait une arme de destruction redoutable. Elle engendre un sentiment d’insécurité, d’incompréhension et de perte de confiance en soi qui grandit un peu plus à chaque attaque, laissant la victime dans la stupeur et dans l’impossibilité de réagir.
Ses différentes formes : directe ou subtile
Selon le milieu socioculturel et le secteur d’activité, on constate différentes formes de harcèlement moral. Des plus directes, visibles dans les secteurs de production (injures, intimidations, propos sexistes, racistes, ridiculisation en public, moqueries sur une particularité physique..) à des mécanismes plus subtils lorsque le niveau hiérarchique est plus élevé (atteinte à la réputation, rétention d’informations, calomnies, refus de communication, ordinateur bloqué, rumeurs malveillantes …).Le harcèlement moral qu’il soit intentionnel ou non vise la négation de l’autre, une atteinte identitaire professionnelle par l’attaque des valeurs fondamentales de l’autre, il est le fait souvent de pervers narcissiques. Il isole la victime et la prive de tout soutien social. Seule, démunie et dans l’incompréhension totale, la personne ne peut réagir face aux attaques répétées et sombre dans de grandes souffrances émotionnelles.
Le terreau du harcèlement moral
Bien que les conditions de travail se soient largement améliorées, l’entreprise est une organisation et un système social, régit par des lois techniques, organisationnelles, financières et humaines dont tous les éléments sont interdépendants et solidaires. Si les hommes doivent en permanence travailler ensemble et coopérer, le harcèlement moral commence souvent par le refus d’une différence (social, vestimentaire, diplôme ou d’écoles fréquentées, couleur de peau, âge, religion, esprit critique..) peu importe cette différence, elle fait peur, elle interpelle, elle agace.Dans une société qui revendique l’interchangeabilité et le culte de la productivité, les salariés, sont amenés à tout faire pour effacer les différences qu’ils n’acceptent pas et le harcèlement moral leur permet de retrouver un semblant d’égalité subjective. De plus, en entreprise comme dans la vie extérieure, il y a des sentiments irrationnels qui entrent en ligne de compte, des jeux de pouvoir et de contre- pouvoir qui impliquent des comportements de jalousie, d’envie et de rivalité. En tant que sentiments inavouables, ils ne sont pas exprimés clairement et de ce fait, ils rendent les individus particulièrement destructeurs entre eux, qu’il s’agisse de relation professionnelle ascendante, de même niveau ou descendante.
L’organisation même du travail peut favoriser les comportements violents. En effet, il faut être réaliste, encore aujourd’hui, certaines pratiques managériales visent à désorganiser le lien social, à monter les services les uns contre les autres ou à humilier les personnes (management par le stress et par la peur), d’autres pratiques ont pour conséquences d’exclure les salariés dont l’âge, l’état de santé ou le niveau de formation ne correspondent plus aux besoins de l’entreprise. Bien que ces pratiques ne soient pas exprimées clairement par la direction, elles poussent de manière insidieuse les managers à utiliser ce type de comportement que l’entreprise ne couvrira pas forcément si un scandale doit éclater. Pour autant, il ne s’agit pas de déresponsabiliser l’attitude des managers qui se disent victimes du système, car ils sont à même en tant qu’adultes de refuser d’utiliser ces pratiques « d’abattage ».
Les managers ont la responsabilité de gérer les conflits avant qu’ils ne dégénèrent en harcèlement, de stopper les premiers agissements hostiles, d’influencer le climat de travail en privilégiant le sentiment de justice, en pratiquant un style managérial centré sur la considération, en consultant leurs équipes et en les respectant. Encore faut-il qu’ils soient eux-mêmes formés à reconnaître ces comportements et à les gérer de manière humaine et adéquate.
Dans le même esprit, les ressources humaines doivent porter attention à la qualité des relations et à la gestion précoce des conflits afin qu’ils ne se transforment pas en harcèlement moral. En cas d’alerte, ne pas faire la politique de l’autruche et faire appel à un tiers extérieur afin d’écouter les parties en présence et les aider à trouver des solutions. Cette prise en charge précoce permet cette reconnaissance des parties nécessaire à la résolution du conflit. De l’autre côté, en cas de doute une enquête avec un cabinet extérieur doit être menée afin de comprendre tous les rouages et définir avec certitude qui est harcelé et qui est harceleur. Il y a parfois des surprises, comme ce salarié d’une entreprise de services qui se disait harcelé par son manager alors qu’en fait après enquête c’était lui le harceleur qui tyrannisait son manager. Attention donc aux conclusions hâtives et à l’emballement collectif.
Ce que dit le droit
La Loi a permis ces dernières années, aux victimes une reconnaissance de leur souffrance et oblige par la même occasion les entreprises à prendre leurs responsabilités dans le cadre de leur obligation quant à la sécurité et à la santé des salariés. Mettre en place des plans de prévention des agissements hostiles et des cellules de médiation pour éviter ou gérer ces situations qui impactent fortement l’ensemble des salariés d’une entreprise.L’article 222-33-2 du Code pénal Français dit : «le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Si , dans la loi de 2002, le salarié devait seulement présenter les faits laissant supposer des preuves de harcèlement, en 2003, le législateur est revenu sur ce mécanisme en demandant à la victime d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. C’est une évolution juridique favorable aux victimes, même si le problème réside souvent au niveau des agressions subtiles ou le recueil des faits est particulièrement difficile. La lenteur des procédures et le risque de victimisation si le système s’emballe entraînent pour les victimes, la mise au placard ou des arrêts maladie pour longue durée. Il est très rare que les victimes reviennent dans l’entreprise où a eu lieu le harcèlement.
La lumière au bout du tunnel
Pour les victimes de harcèlement moral, les conséquences sont désastreuses autant sur le plan physique, psychologique ou social : stress, anxiété, troubles psychosomatiques, dépression, risque suicidaire, stress post traumatique, désillusion (perte de tout espoir), réactivation des blessures passées, perte de sens, peur des autres.2 axes de reconstructions peuvent être enclenchés : d’abord un travail personnel afin d’inciter au respect, mettre des mots sur les évènements vécus, leur résonnance profonde et rechercher un soutien psychologique avec un thérapeute pour se protéger au travail, alerter les RH et les syndicats, puis commencer à décider le changement. Ensuite, vient la nécessité ou non de rechercher dans la justice, la reconnaissance de cette violence afin de pouvoir réapprendre à faire confiance de nouveau.

Laetitia Heslouis - Sophrologue & Fondatrice de Czazen
Moins de stress pour vivre mieuxLaetitia Heslouis (38 ans) Sophrologue & Fondatrice de Czazen....
↧
↧
Risque de suicide: près d'un actif sur trois en France a déjà pensé à mettre fin à ses jours selon une étude
Le HuffPost avec AFP | Publication: 09/09/2013 12h27 CEST | Mis à jour: 09/09/2013 12h27 CEST

Selon l'enquête, 27% des actifs ont déjà pensé au suicide et 3% y ont même pensé "souvent". Ils sont également 12% a rapporter avoir été confrontés au suicide au cours des 12 derniers mois, via un membre de leur famille (27%), un ami (32%), un collègue (37%) un voisin (8%) ou autre (6%).
Avec plus de 10.000 morts par an et plus de 200.000 tentatives, la France connaît un taux de suicides de 14,7 pour 100.000 habitants, bien au dessus de la moyenne de l'Union européenne (10,2 pour 100.000), selon les dernières données de l'Insee.
Pour près de 90% des sondés, les pouvoirs publics n'en font pas assez
Pour 69% des sondés, ce taux de suicide est imputable à la crise que traverse le pays. Ils sont très largement majoritaires (87%) à estimer que les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de la situation en France. Mais dans le même temps, moins d'un tiers des actifs (28%) a conscience que le taux de suicide en France est au dessus de la moyenne,
Du côté des entreprises, 15% des actifs rapportent que la leur "été confrontée à une crise suicidaire" au cours des cinq dernières années. Ils jugent la réponse de l'employeur inadaptée dans 63% des cas (30% "pas du tout adaptée", et 33% "plutôt pas adaptée") et estiment que de tels évènements ont des répercussions négatives dans l'entreprise dans 40% des cas.
Un observatoire du suicide lancé officiellement mardi 10 septembre
L'enquête a été réalisée sur internet du 30 juillet au 20 août, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population active, selon la méthode des quotas.
Le cabinet Technologia, qui est notamment intervenu chez France Télécom après la vague de suicides de 2008-2009, a été l'un des initiateurs de "l'appel des 44", lancé en mai 2012 dans Libération par 44 personnalités issues du monde de la santé, de la recherche, du monde syndical et intellectuel pour la création d'un observatoire du suicide.
Cet observatoire doit être officiellement lancé mardi par la ministre des Affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine.
↧
Porno pour femmes: L'interview d'une réalisatrice de films X
Le porno n’est pas vraiment fait pour les femmes, c’est vrai. Mais cela ne signifie pas que les femmes n’aiment pas le porno – nous n’aimons simplement pas le porno classique qui infériorise souvent les femmes et les font passer pour de simples jouets avec lesquels s’amusent les hommes.
Une femme est en train d’essayer de changer la donne : Petra Joy, dont le film « A taste of joy » vient juste de remporter un « Porna award 2013 » décerné par Dusk !, la seule chaîne de télé porno destinée à un public féminin.
Nous avons profité de l’opportunité de l’interroger sur le féminisme, les femmes dans le porno et la raison pour laquelle elle était rentrée dans cette industrie.
![petra joy]()
Petra sur le tournage de son film A Taste Of Joy
Pourquoi pensez-vous que vos films sont populaires chez les femmes ?
Petra Joy : Je pense que c’est parce qu’ils rendent le porno agréable à regarder pour une femme – la femme est au centre de l’attention et j’emploie des amateurs plutôt que des acteurs. Certains sont amants dans la vraie vie et on y voit beaucoup l’homme – ses belles mains, son corps – qui donne du plaisir à la femme. Beaucoup d’entre nous aimeraient voir ça.
Le porno classique est-il sexiste ?
Petra Joy : Oui, la plupart des films sont faits par des hommes pour des hommes, donc quand les femmes disent qu’elles n’aiment pas ça, c’est parce que ces films ne montrent que très peu les hommes. Le fait que le porno devienne de plus en plus extrême est une tendance inquiétante de cette industrie – une fellation forcée est une mode inquiétante.
Beaucoup de ces films dégradent les femmes et nous devons changer ça. En tant que féministe, c’est important parce qu’on peut se demander pourquoi on laisserait aux mains des hommes toute une catégorie de films.
C’est aussi très inquiétant pour les adultes plus jeunes – je me sens responsable parce que je veux montrer de la diversité, des personnes qui traitent les autres avec respect, et qui respectent aussi les limites.
Nous avons besoin de films porno alternatifs. On est inondé par des images qui ne montrent rien de tout ça. La voie pour y parvenir est celle de l’éducation sexuelle et de l’imagerie – faire l’amour en se protégeant plus, montrer les baisers autant que les scènes de sexe.
Pourquoi n’employez-vous pas d’acteurs ?
Petra Joy : Jusqu’ici, je n’ai pas employé de star du porno car ce que les femmes n’aiment pas dans le porno classique est la léthargie qu’on lit dans les yeux, l’artifice. On a besoin de ressentir de l’authenticité dans ce qu’on voit pour l’apprécier. Si c’est votre travail à plein temps, vous risquez forcément de faire semblant.
Certes, il y a des stars du porno qui peuvent mettre de la passion dans leur travail, mais beaucoup font des choses dont elles n’ont pas envie et le public n’est pas idiot. Il se rend compte quand les gens s’ennuient, qu’ils ont mal ou qu’ils ne sont pas à l’aise.
C’est important pour moi que le sexe se développe sur le tournage. Mon travail ne doit pas être intrusif, il ne doit pas être contraignant. Je ne dis pas : « Coupez », je n’utilise pas un éclairage spécial et je ne vais pas m’approcher pour faire des gros plans. J’aime être surprise ; or, parfois, les gens dans mes films font des choses auxquelles je ne m’attendais pas, et ça, c’est excitant.
(suite de l'interview ci-dessous) ![petra joy]() Vous employez donc des véritables couples ?
Vous employez donc des véritables couples ?
Petra Joy : J’ai souvent filmé des gens qui étaient amants, mais n’entretenaient pas forcément une relation suivie.
Ils partagent mon envie de retrouver la magie et la sensualité du sexe, de valoriser les femmes et de laisser les hommes faire l’expérience de ce que signifie être un objet de désir. Ces gens ne sont pas des exhibitionnistes qui se disent : « Bon sang, ça va être super excitant de faire l’amour devant une caméra ». Ils sont plutôt du genre à dire : « Je pense que ce que vous faites est super, est-ce que je peux participer ? »
Toutes les femmes dans le film sont des féministes engagées. Moi même je fais d’abord ces films pour servir la cause des femmes.
Il est temps désormais que des femmes s’emparent de la caméra, que ce soit pour filmer, produire ou écrire.
Comment en êtes-vous venue à faire ce métier ?
Petra Joy : Dans les années 80, alors que je faisais l’école de cinéma de Cologne, je suis entrée dans le mouvement anti-porno.
J’ai loué 70 films porno, je les ai regardés durant deux semaines et j’ai été très déçue. Je n’étais pas excitée et les images étaient terrifiantes – les femmes se faisaient cracher dessus, gifler… C’était très misogyne.
L’un des films était presque un snuff movie, la pellicule était granuleuse, et des femmes s’y faisaient poursuivre dans une forêt ; elles étaient violées et les hommes les torturaient avec du fil barbelé.
J’ai donc décidé de faire mon premier film qui s’appelait ‘Smash The Chains’ (« Briser les chaînes »), j’avais une vingtaine d’années et j’étais féministe. J’ai ensuite fait des ateliers sur le porno – on étudiait la façon dont le langage et le montage de ces films dégradaient les femmes. J’ai ensuite tourné des documentaires sur le sexe pour la télévision.
Et puis j’ai lancé ma propre entreprise, Strawberry Seductress, qui proposait des séances de photos érotiques pour les femmes et les couples. Mes clients – des hommes dégoûtés du porno classique et des femmes qui souhaitaient trouver quelque chose pour elles – m’ont demandé quels types de films je pouvais leur recommander. Mais je ne savais pas vraiment ce qui aurait pu répondre aux attentes de ces femmes ou de ces couples qui regardaient les films ensemble.
J’avais mon propre matériel de réalisation et je me suis dit : « Pourquoi ne pas le faire moi-même ? » Mon premier film porno s’appelait ‘Sexual Suchi’ - je l’ai filmé en quelques semaines avec un couple d’amis. L’une de mes clientes a financé la production parce qu’elle soutenait l’idée derrière mon travail.
Comment l’industrie porno a réagi à ce film ?
Petra Joy : Elle l’a rejeté – ils ont dit : « On n’y voit pas d’éjaculation faciale, il n’y a pas de star ». Mais, contre toute attente, le film a marché. Les gens ne voulaient plus voir les mêmes trucs de mauvaise qualité, c’était nouveau. Voici comment tout a commencé.
En quoi le porno est-il différent pour les femmes que pour les hommes ?
Petra Joy : En réalité, ce que nous voulons est l’exact opposé de ce que veulent les hommes. La sexualité d’une femme hétéro est l’inverse de celle d’un homme hétéro – les femmes ont bien des choses en commun avec les hommes homosexuels – ce pourquoi elles regardent beaucoup de porno homosexuel.
Par exemple, l’une de mes marques de fabrique est de montrer un homme seul en train de se masturber devant des femmes qui le regardent – en tant que femme hétéro, j’ai envie de voir un homme se donner du plaisir.
Pour moi, l’objet du désir, c’est l’homme. Je filme le gars, ses muscles, ses fesses. Dans un porno classique, vous voyez son sexe et son dos, moi je veux le voir lui. Dans un porno classique, vous voyez deux hommes et une femme ; dans mon film, les femmes sont les héroïnes et je me concentre sur leur orgasme.
Est-ce que les choses sont en train de changer ?
Petra Joy : La révolution dans le porno est en marche, et elle est guidée par des femmes – on ne peut plus nous arrêter ! A travers le monde, de jeunes réalisatrices prennent les choses en main – aux Pays Bas et en Australie.
Je rêve qu’un jour, des femmes produisent plus que la moitié du porno, puisque nous constituons plus de la moitié de l’humanité.
Une seule réalisatrice a déjà remporté un Oscar, seulement 6 % des femmes à Hollywood sont réalisatrices. Les femmes doivent s’emparer d’une caméra et exprimer leur sexualité au monde. Ainsi nous aurons une vue d’ensemble équilibrée, autrement, on nous lave le cerveau.
Toute cette révolution en marche n’est pas motivée par des gains financiers. Quand on parle de porno, toutes ces mauvaises connotations ressortent – la coercition, la drogue – alors que la nouvelle approche est guidée par le choix et la liberté.
Quelles ont été les réactions ? N’y a-t-il pas des femmes qui détesteront toujours le porno ?
Petra Joy : Si vous ne voulez pas regarder du porno, pas de problème. Mais si vous le souhaitez, au moins maintenant il existe quelque chose pour les femmes. Beaucoup de femmes m’envoient des mails, du genre : "Grâce à vous, j’ai essayé l’amour à trois et maintenant je sais comment faire", ce que je trouve génial.
Makeup Artist: Melissa Murphy
Melissa's instagram: http://instagram.com/xmelissamakeupx
Melissa's Twitter: https://twitter.com/xmelissamakeupx
Une femme est en train d’essayer de changer la donne : Petra Joy, dont le film « A taste of joy » vient juste de remporter un « Porna award 2013 » décerné par Dusk !, la seule chaîne de télé porno destinée à un public féminin.
Nous avons profité de l’opportunité de l’interroger sur le féminisme, les femmes dans le porno et la raison pour laquelle elle était rentrée dans cette industrie.

Petra sur le tournage de son film A Taste Of Joy
Pourquoi pensez-vous que vos films sont populaires chez les femmes ?
Petra Joy : Je pense que c’est parce qu’ils rendent le porno agréable à regarder pour une femme – la femme est au centre de l’attention et j’emploie des amateurs plutôt que des acteurs. Certains sont amants dans la vraie vie et on y voit beaucoup l’homme – ses belles mains, son corps – qui donne du plaisir à la femme. Beaucoup d’entre nous aimeraient voir ça.
Le porno classique est-il sexiste ?
Petra Joy : Oui, la plupart des films sont faits par des hommes pour des hommes, donc quand les femmes disent qu’elles n’aiment pas ça, c’est parce que ces films ne montrent que très peu les hommes. Le fait que le porno devienne de plus en plus extrême est une tendance inquiétante de cette industrie – une fellation forcée est une mode inquiétante.
Beaucoup de ces films dégradent les femmes et nous devons changer ça. En tant que féministe, c’est important parce qu’on peut se demander pourquoi on laisserait aux mains des hommes toute une catégorie de films.
C’est aussi très inquiétant pour les adultes plus jeunes – je me sens responsable parce que je veux montrer de la diversité, des personnes qui traitent les autres avec respect, et qui respectent aussi les limites.
Nous avons besoin de films porno alternatifs. On est inondé par des images qui ne montrent rien de tout ça. La voie pour y parvenir est celle de l’éducation sexuelle et de l’imagerie – faire l’amour en se protégeant plus, montrer les baisers autant que les scènes de sexe.
Pourquoi n’employez-vous pas d’acteurs ?
Petra Joy : Jusqu’ici, je n’ai pas employé de star du porno car ce que les femmes n’aiment pas dans le porno classique est la léthargie qu’on lit dans les yeux, l’artifice. On a besoin de ressentir de l’authenticité dans ce qu’on voit pour l’apprécier. Si c’est votre travail à plein temps, vous risquez forcément de faire semblant.
Certes, il y a des stars du porno qui peuvent mettre de la passion dans leur travail, mais beaucoup font des choses dont elles n’ont pas envie et le public n’est pas idiot. Il se rend compte quand les gens s’ennuient, qu’ils ont mal ou qu’ils ne sont pas à l’aise.
C’est important pour moi que le sexe se développe sur le tournage. Mon travail ne doit pas être intrusif, il ne doit pas être contraignant. Je ne dis pas : « Coupez », je n’utilise pas un éclairage spécial et je ne vais pas m’approcher pour faire des gros plans. J’aime être surprise ; or, parfois, les gens dans mes films font des choses auxquelles je ne m’attendais pas, et ça, c’est excitant.
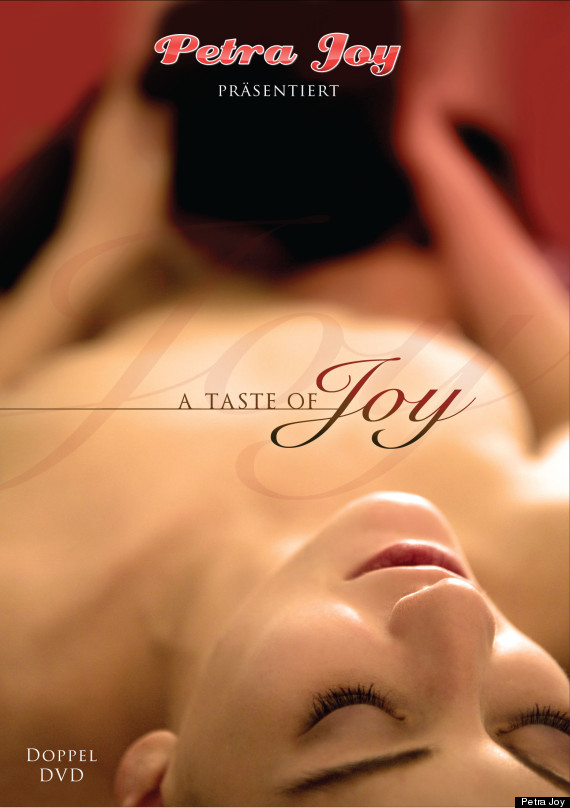 Vous employez donc des véritables couples ?
Vous employez donc des véritables couples ?Petra Joy : J’ai souvent filmé des gens qui étaient amants, mais n’entretenaient pas forcément une relation suivie.
Ils partagent mon envie de retrouver la magie et la sensualité du sexe, de valoriser les femmes et de laisser les hommes faire l’expérience de ce que signifie être un objet de désir. Ces gens ne sont pas des exhibitionnistes qui se disent : « Bon sang, ça va être super excitant de faire l’amour devant une caméra ». Ils sont plutôt du genre à dire : « Je pense que ce que vous faites est super, est-ce que je peux participer ? »
Toutes les femmes dans le film sont des féministes engagées. Moi même je fais d’abord ces films pour servir la cause des femmes.
Il est temps désormais que des femmes s’emparent de la caméra, que ce soit pour filmer, produire ou écrire.
Comment en êtes-vous venue à faire ce métier ?
Petra Joy : Dans les années 80, alors que je faisais l’école de cinéma de Cologne, je suis entrée dans le mouvement anti-porno.
J’ai loué 70 films porno, je les ai regardés durant deux semaines et j’ai été très déçue. Je n’étais pas excitée et les images étaient terrifiantes – les femmes se faisaient cracher dessus, gifler… C’était très misogyne.
L’un des films était presque un snuff movie, la pellicule était granuleuse, et des femmes s’y faisaient poursuivre dans une forêt ; elles étaient violées et les hommes les torturaient avec du fil barbelé.
J’ai donc décidé de faire mon premier film qui s’appelait ‘Smash The Chains’ (« Briser les chaînes »), j’avais une vingtaine d’années et j’étais féministe. J’ai ensuite fait des ateliers sur le porno – on étudiait la façon dont le langage et le montage de ces films dégradaient les femmes. J’ai ensuite tourné des documentaires sur le sexe pour la télévision.
Et puis j’ai lancé ma propre entreprise, Strawberry Seductress, qui proposait des séances de photos érotiques pour les femmes et les couples. Mes clients – des hommes dégoûtés du porno classique et des femmes qui souhaitaient trouver quelque chose pour elles – m’ont demandé quels types de films je pouvais leur recommander. Mais je ne savais pas vraiment ce qui aurait pu répondre aux attentes de ces femmes ou de ces couples qui regardaient les films ensemble.
J’avais mon propre matériel de réalisation et je me suis dit : « Pourquoi ne pas le faire moi-même ? » Mon premier film porno s’appelait ‘Sexual Suchi’ - je l’ai filmé en quelques semaines avec un couple d’amis. L’une de mes clientes a financé la production parce qu’elle soutenait l’idée derrière mon travail.
Comment l’industrie porno a réagi à ce film ?
Petra Joy : Elle l’a rejeté – ils ont dit : « On n’y voit pas d’éjaculation faciale, il n’y a pas de star ». Mais, contre toute attente, le film a marché. Les gens ne voulaient plus voir les mêmes trucs de mauvaise qualité, c’était nouveau. Voici comment tout a commencé.
En quoi le porno est-il différent pour les femmes que pour les hommes ?
Petra Joy : En réalité, ce que nous voulons est l’exact opposé de ce que veulent les hommes. La sexualité d’une femme hétéro est l’inverse de celle d’un homme hétéro – les femmes ont bien des choses en commun avec les hommes homosexuels – ce pourquoi elles regardent beaucoup de porno homosexuel.
Par exemple, l’une de mes marques de fabrique est de montrer un homme seul en train de se masturber devant des femmes qui le regardent – en tant que femme hétéro, j’ai envie de voir un homme se donner du plaisir.
Pour moi, l’objet du désir, c’est l’homme. Je filme le gars, ses muscles, ses fesses. Dans un porno classique, vous voyez son sexe et son dos, moi je veux le voir lui. Dans un porno classique, vous voyez deux hommes et une femme ; dans mon film, les femmes sont les héroïnes et je me concentre sur leur orgasme.
Est-ce que les choses sont en train de changer ?
Petra Joy : La révolution dans le porno est en marche, et elle est guidée par des femmes – on ne peut plus nous arrêter ! A travers le monde, de jeunes réalisatrices prennent les choses en main – aux Pays Bas et en Australie.
Je rêve qu’un jour, des femmes produisent plus que la moitié du porno, puisque nous constituons plus de la moitié de l’humanité.
Une seule réalisatrice a déjà remporté un Oscar, seulement 6 % des femmes à Hollywood sont réalisatrices. Les femmes doivent s’emparer d’une caméra et exprimer leur sexualité au monde. Ainsi nous aurons une vue d’ensemble équilibrée, autrement, on nous lave le cerveau.
Toute cette révolution en marche n’est pas motivée par des gains financiers. Quand on parle de porno, toutes ces mauvaises connotations ressortent – la coercition, la drogue – alors que la nouvelle approche est guidée par le choix et la liberté.
Quelles ont été les réactions ? N’y a-t-il pas des femmes qui détesteront toujours le porno ?
Petra Joy : Si vous ne voulez pas regarder du porno, pas de problème. Mais si vous le souhaitez, au moins maintenant il existe quelque chose pour les femmes. Beaucoup de femmes m’envoient des mails, du genre : "Grâce à vous, j’ai essayé l’amour à trois et maintenant je sais comment faire", ce que je trouve génial.
Makeup Artist: Melissa Murphy
Melissa's instagram: http://instagram.com/xmelissamakeupx
Melissa's Twitter: https://twitter.com/xmelissamakeupx
↧
Enya - Watermark
↧
12 conseils pour lutter contre le burn-out
Le HuffPost | Par Stanislas Kraland Publication: 15/05/2013 07h57 CEST | Mis à jour: 25/07/2013 18h33 CEST

Pour le philosophe Pascal Chabot, le burn-out relève de la "pathologie de civilisation". Ce n'est pas seulement "un trouble individuel qui affecte certaines personnes mal adaptées au système, ou trop dévouées, ou ne sachant pas (ou ne pouvant pas) mettre des limites à leur investissement professionnel," explique-t-il. C'est aussi "un trouble miroir où se reflètent certaines valeurs excessives de notre société: son culte du plus, du trop, de la performance, de la maximisation, tout cela démultiplié par des technologies qui imposent souvent leur temporalité à l'Homme."
Mais au-delà du constat, comment s'en préserver? Dans son environnement de travail, quel comportement adopter pour ne pas se retrouver en situation de burn-out? Si rien ne remplace une véritable thérapie en cas de problème grave, il existe néanmoins des moyens pour prévenir le risque de dépression au travail, ou le réduire. Comment? Notre rubrique C'est la vie a posé la question à Stéphanie Bertholon, psychologue au Centre de traitement du stress et de l'anxiété et auteure de Vivre mieux dans un monde stressant (Odile Jacob).
↧
↧
France-Telecom/Orange : panne géante, effet boomerang d’une politique d’harcèlement moral ?
 Simple hasard, signe des dieux, retour de bâton, effet boomerang ?
Simple hasard, signe des dieux, retour de bâton, effet boomerang ?Alors que le groupe France telecom vient vendredi d’être mis en examen pour harcèlement moral dans l’enquête sur les suicides survenus en 2008-2009, le réseau mobile d’Orange est perturbé depuis ce vendredi après-midi au niveau national, impactant les 26 millions d’abonnés.
Les vieux de la veille comme on dit, ceux qui ont l’expérience, bref toute la richesse technique de l’opérateur auraient-ils fait les frais de la politique menée par France Telecom en vue de supprimer – en dehors de tout plan social – 22.000 emplois, sans capitaliser sur l’expérience acquise par ses collaborateurs depuis de nombreuses années ? Qui sait … tel pourrait être bien le cas.
« L’entreprise va enfin pouvoir se défendre deux ans après l’ouverture de l’enquête. France Télécom conteste avoir mis en place un système destiné à créer des souffrances chez ses salariés« , a en tout état de cause déclaré Me Chemarin, avocate de l’opérateur.
Pourtant le livre de Dominique Decèze, publié en 2004, intitulé « La Machine à Broyer » faisait d’ores et déjà état de conditions de travail mettant en péril l’intégrité mentale des salariés du groupe France Telecom. L’auteur avait alors indiqué que plusieurs études avaient « établi un lien scientifique entre les restructurations et la souffrance physique et psychique des employés« . De nouvelles méthodes de gestion ayant été alors brutalement introduites, selon lui : recherche de la performance, compétition entre salariés, conquête des clients. « La direction a systématiquement cherché à détruire tout collectif de travail qui pouvait faire obstacle à la montée de l’individualisme« ajoutait-il, déjà .
Plusieurs exemples avaient été cités à ce sujet : « Des personnes sans affectation parce qu’on leur refusait toujours des postes, un cadre muté six fois de suite en cinq ans sans raison, des couples séparés par mutation professionnelle ». « On a vu des services déménager à répétition dans un département, contraignant les employés à suivre ». Selon lui, « France Télécom a servi de laboratoire à la première grande remise en cause de la fonction publique. Cela préfigure ce qui risque d’arriver à La Poste ou à EDF-GDF ».
Dans leur rapport annuel sur la santé au travail, présenté en mars 2007 au comité d’établissement de la direction régionale centre-est de France Télécom, des médecins du travail s’inquiétaient d’ores et déjà du « mal-être » existant dans les sites France Télécom de Rône-Alpes et Auvergne.
« Le stress, le désarroi, les troubles anxio-dépressifs liés aux transformations du travail ne cessent de s’accroître chez le personnel« , détaillent-ils, en évoquant des salariés qui « ont de plus en plus de mal à se reconnaître dans ce qu’ils font ».
En mars 2010, Le Parisien/Aujourd’hui en France indiquait qu’ un rapport de l’Inspection du Travail sur les suicides à France Télécom faisaitt état de faits accablants pour la direction de l’entreprise.
Le terme de « harcèlement moral » était ( enfin ?) lâché …
Bien évidemment le quotidien ne se basait pas sur des rumeurs ou des ragots pour ce faire, bien au contraire … Il publiait des extraits du document de 82 pages remis le 4 février 2010 au parquet de Paris.
Lequel évoquait une « mise en danger d’autrui du fait de la mise en oeuvre d’organisations du travail de nature à porter des atteintes graves à la santé des travailleurs » et des« méthodes de gestion caractérisant le harcèlement moral » .
Pour l’inspectrice du travail Sylvie Catala, les tentatives de suicide qui « ne sont pas des cas particuliers »étaient d’ores et déjà liées à « la politique de réorganisation et de management » menée dans l’entreprise.
Le Parisien indiquait alors que , trois personnes seraient mises en cause dans le rapport, notamment Didier Lombard , ancien P-DG du groupe, remplacé par Stéphane Richard, à la « faveur » si j’ose dire … des suicides des salariés …. et de la pression médiatique qui s’en est suivie. Selon le Figaro, Louis-Pierre Wenès, l’ancien directeur des opérations France, et Olivier Barberot, l’ancien directeur des ressources humaines, auraient également été pointés du doigt par l’Inspection du Travail.
S’appuyant sur l’enquête menée par le cabinet Technologia , auprès des salariés de France Télécom, Sylvie Catala soulignait alors que l’ex-direction a été alertée « à maintes reprises » des effets produits par sa politique de management sur «la santé des travailleurs».
Médecins du travail, représentants syndicaux, caisses régionales d’assurance-maladie et «même la justice» auraient tiré la sonnette d’alarme depuis 2006. Chose que nous faisions ici-même dès 2007 … voire même 2006, nous alarmant de la méthode employée par la direction pour annoncer la « vague » de 22.000 suppressions d’emplois.
↧
Réseaux sociaux au bureau et relations au travail : Le gap des générations
Une étude menée aux Etats-Unis par Millennial branding pour le compte d’American express révèle un fossé persistant entre les Managers et la génération Y notamment sur la question de l’utilisation des réseaux sociaux au travail. La question des réseaux sociaux au travail 54% des managers pensent que leurs employés devraient avoir le droit de consulter leurs profils sociaux au bureau contre 69% des membres de la génération Y. Ils sont seulement 16% pour les managers et 17% pour les membres de la génération Y à considérer que l’utilisation des réseaux sociaux pour des conversations professionnelles est important ou très important. Amis pas Amis sur les réseaux sociaux ? Seuls 14% des managers se sentent à l’aise pour devenir amis de leurs employés sur les réseaux sociaux contre 24% des membres de la génération Y. Une proportion qui passe à 24% pour les Managers et 32% pour les membres de la génération Y sur Linkedin. Parallèlement 38% des membres de la génération Y se sentent à l’aise dans les introductions sur les réseaux sociaux contre 19% des managers. Manager et Millennials : un regard générationnel contrasté Si les membres de la génération Y s’accordent à reconnaitre que leurs manager apportent Expérience à 59% et sagesse à 41%. Le regard des managers sur la génération Y est plus contrasté, ils estiment en effet que leurs employés ont des attentes irréalistes en termes de rémunération (51%) éthique de travail (47%) et qu’ils sont souvent distraits (46%). Les critères de promotions 61% des managers et 65% des membres de la génération Y s’accordent à reconnaitre que les compétences générales et comportementales (Soft Skills) constituent le premier critère important en terme de promotion, devant l’expertise. Les trois compétences les plus valorisées par les managers sont à 87% la capacité de prioritiser, à 86% l’attitude positive et à 85% les qualités de travail en équipe. Entreprenariat et évolution Autre enseignement de l’étude 73% des managers sont prêts à favoriser une évolution de leurs employés dans la société et 58% à faciliter leurs ambitions entrepreneuriales. Côté génération Y seuls 48% souhaitent évoluer dans la société et 40% dans l’entreprenariat. Plus de Mentoring Une forte majorité des la génération Y exprime des besoins en terme de mentorat. Ils sont ainsi 53% à indiquer qu’un programme de mentoring les aiderait à être meilleurs et plus productifs dans leur travail. Les moyens de communications préférés Pour 66% des managers et 62% des représentants de la génération Y les réunions face à face sont le meilleur moyen de communiquer, devant l’email pour 26% des managers et 25% des membres de la génération Y. Devenir Manager Combien de temps pour devenir manager ? L’appréciation diffère entre les générations. 75% des managers estiment qu’il faut quatre ans avant d’occuper la fonction (66% pour la génération Y). 32% des managers interrogés estiment même qu’il faut 8 ans pour être promu manger contre 27% pour les millennials. L’appréciation des diplômes 43% des managers considèrent les diplômes sont un avantage voire un pré requis (10%). Côté millennials, ils sont beaucoup pus valorisés 60% les considèrent comme un avantage et 22% comme un pré-requis. Conclusion de Dan Schawbel auteur de l’étude et CEO de Millennial Branding “La génération Y est cruciale pour le développement et la croissance de l’économie, pourtant les managers en ont une impression négative ce qui crée des drames au bureau. Les managers devraient être clairs sur leurs attentes, les assister dans leurs carrières et les aider à développer les compétences dont ils auront besoin aujourd’hui et à l’avenir”.
En savoir plus sur http://www.viuz.com/2013/09/09/reseaux-sociaux-au-bureau-et-relations-au-travail-le-gap-des-generations/#6iOSixwQpIGq0sUu.99
En savoir plus sur http://www.viuz.com/2013/09/09/reseaux-sociaux-au-bureau-et-relations-au-travail-le-gap-des-generations/#6iOSixwQpIGq0sUu.99
Une étude menée aux Etats-Unis par Millennial branding pour le compte d’American express révèle un fossé persistant entre les Managers et la génération Y notamment sur la question de l’utilisation des réseaux sociaux au travail. La question des réseaux sociaux au travail 54% des managers pensent que leurs employés devraient avoir le droit de consulter leurs profils sociaux au bureau contre 69% des membres de la génération Y. Ils sont seulement 16% pour les managers et 17% pour les membres de la génération Y à considérer que l’utilisation des réseaux sociaux pour des conversations professionnelles est important ou très important. Amis pas Amis sur les réseaux sociaux ? Seuls 14% des managers se sentent à l’aise pour devenir amis de leurs employés sur les réseaux sociaux contre 24% des membres de la génération Y. Une proportion qui passe à 24% pour les Managers et 32% pour les membres de la génération Y sur Linkedin. Parallèlement 38% des membres de la génération Y se sentent à l’aise dans les introductions sur les réseaux sociaux contre 19% des managers. Manager et Millennials : un regard générationnel contrasté Si les membres de la génération Y s’accordent à reconnaitre que leurs manager apportent Expérience à 59% et sagesse à 41%. Le regard des managers sur la génération Y est plus contrasté, ils estiment en effet que leurs employés ont des attentes irréalistes en termes de rémunération (51%) éthique de travail (47%) et qu’ils sont souvent distraits (46%). Les critères de promotions 61% des managers et 65% des membres de la génération Y s’accordent à reconnaitre que les compétences générales et comportementales (Soft Skills) constituent le premier critère important en terme de promotion, devant l’expertise. Les trois compétences les plus valorisées par les managers sont à 87% la capacité de prioritiser, à 86% l’attitude positive et à 85% les qualités de travail en équipe. Entreprenariat et évolution Autre enseignement de l’étude 73% des managers sont prêts à favoriser une évolution de leurs employés dans la société et 58% à faciliter leurs ambitions entrepreneuriales. Côté génération Y seuls 48% souhaitent évoluer dans la société et 40% dans l’entreprenariat. Plus de Mentoring Une forte majorité des la génération Y exprime des besoins en terme de mentorat. Ils sont ainsi 53% à indiquer qu’un programme de mentoring les aiderait à être meilleurs et plus productifs dans leur travail. Les moyens de communications préférés Pour 66% des managers et 62% des représentants de la génération Y les réunions face à face sont le meilleur moyen de communiquer, devant l’email pour 26% des managers et 25% des membres de la génération Y. Devenir Manager Combien de temps pour devenir manager ? L’appréciation diffère entre les générations. 75% des managers estiment qu’il faut quatre ans avant d’occuper la fonction (66% pour la génération Y). 32% des managers interrogés estiment même qu’il faut 8 ans pour être promu manger contre 27% pour les millennials. L’appréciation des diplômes 43% des managers considèrent les diplômes sont un avantage voire un pré requis (10%). Côté millennials, ils sont beaucoup pus valorisés 60% les considèrent comme un avantage et 22% comme un pré-requis. Conclusion de Dan Schawbel auteur de l’étude et CEO de Millennial Branding “La génération Y est cruciale pour le développement et la croissance de l’économie, pourtant les managers en ont une impression négative ce qui crée des drames au bureau. Les managers devraient être clairs sur leurs attentes, les assister dans leurs carrières et les aider à développer les compétences dont ils auront besoin aujourd’hui et à l’avenir”.
En savoir plus sur http://www.viuz.com/2013/09/09/reseaux-sociaux-au-bureau-et-relations-au-travail-le-gap-des-generations/#o6DS6vgIOvACrZ7M.99
En savoir plus sur http://www.viuz.com/2013/09/09/reseaux-sociaux-au-bureau-et-relations-au-travail-le-gap-des-generations/#o6DS6vgIOvACrZ7M.99
↧
Réinventer les prières
Giotto : Le Rêve de Joachim
A force d’ânonner sans conviction les mêmes prières depuis des siècles, celles-ci se sont vidé de leur substance. Elles expriment pourtant souvent des choses très belles un peu délaissées, comme la gratitude, le remerciement, l’émerveillement, l'amour… Mais dans un monde désenchanté elles ne sont devenues que mots appris par cœur, paroles répétées sans foi, outils d’obéissance, alors qu’elles devraient être de magnifiques portes vers le ciel.
Tout ça pour dire que dans un livre de Maud Séjournant (qu’il faut décidemment lire absolument !) :« La Spirale Initiatique » (Albin Michel), j’ai lu hier une bien curieuse chose.
Un érudit américain du nom de Neil Douglas-Klotz, s’est occupé de retrouver les textes araméens à l’origine de la version grecque de la Bible, version qui fut ensuite la source des traductions en langue moderne (si ce fait t’avait échappé, et si j’ai bien compris, la Bible fut d’abord écrite en hébreu, puis traduite en araméen qui était la langue de l’époque dans cette région du monde, et entre autre –plus tard- celle de Jésus ; puis traduite en grec, puis en latin, puis dans les langues modernes. Les principales versions de la Bible que nous connaissons, sont donc des traductions de traductions, de traductions, de traductions, datant d’il y a bien longtemps…).
A la lumière de nos connaissances actuelles en hébreu (langue éminemment complexe à traduire), innombrables sont les exégèses qui reviennent sur des points de la Bible mal traduits, éclairant le texte de nouvelles compréhensions (Annick de Souzenelle, entre autre, en a beaucoup parlé).
Pourquoi les autorités vaticanes ne cherchent-elles pas à médiatiser cette réflexion et ces nouvelles traductions, voilà une question que l’on peut se poser, même si l’on a déjà une idée de la réponse…
Donc cet érudit à retrouver ces premières traductions de l’hébreu en araméen, les a traduites en anglais et les a publiées. Ses livres n’étant pas à ce jour traduits en français, Maud Séjournant propose dans son livre la traduction en français d’une des prières les plus connues : le Notre Père.
Si tu l’as oublié, cette prière consiste en ceci :
« Notre Père qui êtes aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen. »
Et en voici maintenant la version traduite directement de la traduction araméenne d’origine proposée par Neil Douglas-Klotz :
« Ô, Toi qui donnes vie, Père-Mère du Cosmos,
Dirige ta lumière à l’intérieur de nous, et rends-la utile
Pour que ton nom y vive pleinement,
Créé en nous maintenant ton règne d’unité,
Ton seul désir alors agit avec les nôtres, dans toute lumière et toutes formes.
Accorde-nous ce dont nous avons besoin chaque jour en pain et en conscience
Efface les traces que nos échecs ont créées e notre cœur
De même que nous nettoyons notre cœur du poison de la rancune.
Ne laisse pas la surface des choses nous maintenir dans l’illusion,
Mais libère-nous de ce qui nous entrave
De toi naissent toute volonté et le pouvoir d’accomplir,
Et le chant qui donne de la beauté à toute chose
Et qui à chaque instant renaît.
En toute vérité, ces paroles sont puissantes,
Qu’elles soient la terre où mes actions s’enracinent pour grandir ».
Avoue que ça change tout, n’est-ce pas ?...
Et puisque l’on est dans ce cercle-là, une autre chose intéressante.
Maud Séjournant, à un moment, parle de l’Immaculée Conception. En expliquant que le sens de cette expression n’était pas tant « née sans l’intervention biologique d’un homme », mais : « née sans aucun péché ».
Or, il se trouve qu’il est dit que Marie est née d’un couple très âgée ; sa mère avait même passé l’âge de la ménopause. Sa théorie est que, de par leur grand âge, « ses parents avaient eu le temps d’avoir fait un travail de réconciliation avec leur être profond au travers de nombreux pardons, purifications, transformations. Bref, ils s’étaient délivrés de leur ancien conditionnement et avaient retrouvé leur condition d’innocence et de pureté originales que certaines traditions appellent « l’éveil ». Donc, Marie n’a pas été élevée avec le fardeau culturel véhiculé dans l’inconscience habituelle mais avec l’amour inconditionnel de ses parents dans l’absence de notions de faute ou de honte de ce qu’elle était ; c’est cela être né sans le péché originel, c’est-à-dire sans aucun sentiment d’inadéquation de ce que l’on est… »
Je trouve pour ma part cette hypothèse très intéressante, dans la mesure où elle rejoint aussi certaines approches de la psycho généalogie. En tout cas, ça ouvre des portes…
Une précision toutefois, le livre dont je cite les extraits est un livre sur le chamanisme et plus précisément sur une tentative d’inscrire ces pratiques dans le monde occidental. Cela pour éviter toute confusion, les seules références à la religion chrétienne dans ce livre sont celles que je cite, le reste parle d’autre chose, et c’est tout autant passionnant, pour ne pas dire plus…
PS : Après avoir écrit ce texte, j’en ai, comme toujours, cherché une illustration. A savoir ce « Rêve de Joachim » de Giotto. Pour me rendre compte après que Joachim était le prénom du père de Marie, et que c'est de lui qu'il est question dans cette peinture… Ce que je ne savais pas ! Bizarre, vous avez dit bizarre ?...
↧
House Trance
↧
↧
Oser les émotions au travail

Tristesse, joie, colère... Les chercheurs ont prouvé que les émotions tout comme l'intuition participent à accélérer la prise de décision. Le manager a donc intérêt à les reconnaître et à les exprimer.
istock
Tristesse, anxiété, colère, joie... Les émotions sont hélas encore taboues dans l'entreprise. A tort. Communiquer ses sentiments permet de gagner en humanité et fait du bien à l'équipe, explique Nathalie Dédebant, coach et consultante chez Cegos.
Les chercheurs ont prouvé que les émotions tout comme l'intuition participent à accélérer la prise de décision. Le manager a donc intérêt à reconnaître et à exprimer ce qui le touche. D'autant plus qu'à trop contenir ses états d'âme, c'est le corps qui parle pour dire ce qui ne va pas. En outre, s'ouvrir à ses collaborateurs incitera ceux-ci à s'ouvrir en retour, ce qui va resserrer les liens dans l'équipe. Mode d'emploi sur cinq émotions majeures.
1. La peur : l'émotion qui paralyse
La peur maîtresse consiste à ne pas être apte à faire face à une situation difficile. Elle se décline en trois catégories selon le psychologue américain Will Schultz : la peur d'être ignoré ("Je ne suis qu'un pion"), la peur d'être humilié ("Je n'y arrive pas"), la peur d'être rejeté ("Je ne suis pas apprécié"). Mal maîtrisée, elle crée des rigidités dans le comportement. Et peut aboutir au sur-contrôle de ses collaborateurs et de soi-même. En outre, elle se cache souvent sous une autre émotion : la colère. C'est ce qu'on appelle un "racket émotionnel". Il faut alors savoir la dénicher.>>> La solution. D'abord, s'avouer sa peur. Puis la transformer en challenge avec des moyens et un plan d'action. C'est cela que vous détaillerez aux autres. Car confier sa peur est impossible parce qu'elle est contagieuse.
Si vous avez une grosse mission avec la crainte de ne pas l'assumer, vous pouvez ainsi déclarer en réunion : "Je reconnais que le projet Z peut faire un peu peur, mais voilà nos atouts." Ou "Nous avons affaire à un réel défi et ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir compter sur vous." Dès lors, vous vous rassurez tout en restant stimulant pour les autres.
Faites de même envers vous, sur une peur plus personnelle, celle de négocier avec votre patron, par exemple.
2. La colère : l'émotion froide ou explosive
Cette émotion est souvent associée à l'agressivité. Pourtant, elle est vitale car elle permet de déplacer un obstacle, de le contourner ou de le fuir. Elle sert à identifier un besoin de changement et offre la possibilité de faire évoluer les choses. L'énoncer clairement évitera une réaction violente ou coupante.>>> La solution. Il faut canaliser sa colère en prenant du recul et la manifester en allant droit au but tout en rappelant le contexte. Restez factuel. "Vous êtes toujours en retard, j'aimerais que ça change". " Votre contribution est minime, je suis en colère" ou "Ca m'agace", "Cela ne me plaît pas". Si vous restez calme et posé , ce sera bien perçu et chacun pourra y mettre du sien. Par ailleurs ça vous donnera de l'assurance, de la fermeté. Vous serez écouté et respecté.
3. La tristesse : l'émotion qui isole
Cette émotion est souvent assimilée au champs privé et passe pour de la faiblesse. Or la taire c'est risquer de craquer en public ou de rester enfermé dans son bureau, les yeux rougis et ruminant. Vous laissez alors la place à toutes les interprétations possibles et risquez générer de l'anxiété dans l'équipe.>>> La solution. Parlez d'abord du contexte et des faits pour chasser l'émotivité dans les propos et faire la place au rationnel, tout en témoignant de votre sensibilité, de votre capacité à tre affecté. Dévoilez-vous plutôt en face-à-face. Exemple: "Nous sommes en réorganisation, Jules et Zoé doivent nous quitter pour un autre service, je suis triste." Vous dites en outre tout haut ce que pensent leurs collègues tout bas, secoués eux aussi.
Pour le registre personnel - deuil, divorce, maladie - restez plus réservé. "En ce moment, je vis une situation compliquée, difficile à surmonter". Ne rentrez pas dans les détails, vous avez donné du sens aux autres, ça suffit.
4. La honte : l'émotion qui taraude
C'est une émotion complexe qui mêle peur et colère qu'on retourne contre soi. Vous vous trouvez "nul", incompétent parce que vous avez rendu un dossier bâclé ou que vous avez commis une bourde envers un collaborateur. Et ça vous ronge.>>> La solution. Mettre de cté le jugement négatif sur soi et trouver des formules qui réparent la situation. Il s'agit d'avoir les mots justes pour dire sa honte à son interlocuteur. "Je me sens mal à l'aise", "je suis confus, je me suis mal conduit"... Vous pouvez même tenter "j'ai un peu honte..."
5. La joie : l'émotion délaissée
Cette émotion positive n'est pas si facile à extérioriser. Le manager a peur de montrer sa reconnaissance au risque de récolter des demandes d'augmentation, peur de se réjouir de sa promotion, de crainte des jalousies...>>> La solution. Partager naturellement sa satisfaction sans la différer. "J'aime bien travailler avec vous." "Ce dossier est réussi, je suis très content". C'est simple, court et ça met du baume au coeur de l'intéressé et à celui de l'entourage.
↧
Indiens
↧
Du management participatif... au management coopératif
Coopérer pour construire et donner du sens au management
Introduction
La crise actuelle n’a pas que des répercussions sur nos économies, elle impacte également les entreprises et leur fonctionnement, à travers le management. Celui-ci est très sensible aux évolutions de l’environnement et on peut toujours corréler les « modes managériales » et le contexte économique. Les théories de la planification se sont ainsi développées dans les années 60, au moment de la croissance et avec une visibilité économique optimale. Dans les années 30, les premiers auteurs de l’école des relations humaines ont mis en avant la nécessité pour les employés de participer à la gestion courante de l’entreprise et à ses décisions ; remettant en cause le modèle classique et hiérarchique présenté par Fayol et Taylor. Politiquement, elle a fait l’objet de l’ordonnance célèbre du général de Gaulle en 1967, sur la participation aux profits. Cette vision « financière » de la participation est toujours très appréciée des salariés et constitue même un outil pour les gouvernements (on se souvient des décisions de déblocage en 1994, 2004 et 2005 pour relancer la consommation des ménages). La participation aux bénéfices est complétée par un système d’intéressement et de nombreux dispositifs d’épargne salariale, développés par les entreprises.Cependant, l’approche plus « managériale » de la participation n’a pas toujours connue le même succès. Les modèles présentés dans les années 80 semblaient séduisants en théorie (1.1.) et bien adaptés au contexte de l’époque. La culture d’entreprise forte était la norme et le management participatif a pu constituer une modalité de renforcement de cette culture. Cependant, les méthodes présentées ont été souvent critiquées et pas nécessairement bien mises en place dans les entreprises (1.2.), ce qui a entrainé de nombreuses désillusions. Mais la crise du début des années 2000 a mis en exergue les faiblesses d’un management par la performance et souvent aussi par le stress. On a pu ainsi observer un renouveau des théories de la coopération et la présentation de principes de management solides et évidents (2.1.). Dans ce contexte, certaines réussites sont venues valider cette approche (2.2.). Ainsi, le modèle de la SCOP a pu perdurer et se développer. Il est présenté aujourd’hui comme une bonne alternative en cas de difficultés d’entreprises. C’est donc un véritable management de la confiance qui se dessine autour de certaines expériences, de plus en plus nombreuses, basées sur la coopération et l’intelligence collective.
1. Le management participatif : des modèles aux désillusions
De nombreux auteurs ont travaillé sur la notion de participation pour développer une véritable conception du management dans laquelle chaque individu doit trouver sa place dans l’entreprise et contribuer à la performance collective.1.1. Des modèles séduisants et contextualisés
Pour définir le périmètre du management participatif
L’étude des pratiques de certaines entreprises, dans les années 90, a pu permettre de définir différentes formes de participation (six en tout) présentées par Jacques Rojot (Les nouvelles stratégies sociales des entreprises : les modes de gestion participatifs, Dalloz, 1995) :
- La participation aux profits ;
- La participation à la propriété de l’entreprise ;
- La participation à la prise de décision de gestion ;
- La participation à l’amélioration des conditions de travail ;
- La participation à la dynamique de développement de l’entreprise ;
- La participation à « l’ordre civique » de l’entreprise, c’est à dire à sa responsabilisation.
L’émergence : les travaux de Peter Drucker
Peter Drucker n’est pas le précurseur de cette école mais bien l’auteur qui est allé le plus loin dans l’analyse et le développement de modèles de management participatif. Son concept de communauté de production, mettant en avant les besoins sociaux des individus et ses travaux sur la DPO (direction par objectifs) ont permis l’émergence du concept de direction participative par objectifs dans les années 70. Dans son ouvrage The practice of management, en 1954, il pose les bases de la DPO. Il s’agit de fixer aux diverses unités des objectifs quantitatifs/qualitatifs à atteindre au terme d’une période déterminée. Cet objectif doit permet de focaliser les énergies et de donner un sens au travail. Mais la notion a surtout été affinée par d’autres auteurs qui ont emboîté le pas à P. Drucker, dans les années 70.
Le positionnement de " l’école du management participatif”
Il n’y a pas, à proprement parler, une école du management participatif mais on peut regrouper différents auteurs, sous cette approche, qui considèrent l’organisation comme un système ouvert avec une vision sociale. Il s’agit de mobiliser au travers de la culture d’entreprise et de responsabiliser tous les collaborateurs autour des objectifs de l’organisation. Les principaux auteurs sont William Ouchi, auteur de la Théorie Z, mais aussi James March et surtout Octave Gélinier. Octave Gélinier est parti du concept de départ de DPO pour le faire évoluer en « DPPO » (direction participative par objectifs). Les objectifs sont fixés de manière collective pour susciter la motivation, grâce à des négociations et concertations au sein des équipes de production. Il faut donc que l’entreprise soit organisée en départements autonomes capables d’estimer et de chercher à atteindre des objectifs opérationnels (la plupart à l’échéance d’un an). Dans son ouvrage majeur, Direction participative par objectifs (1968), O. Gélinier estime que la DPPO est un nouveau style de management, avec des objectifs cohérents et la mise en place de véritables procédures participatives. Dans son ouvrage, Le secret des structures compétitives (1977, éditions hommes et techniques), il dénonce la bureaucratie mécaniste et propose quelques principes de « management moderne », basés sur l’efficacité, en particulier dans la prise de décision. Pour lui, l’entreprise doit s’adapter à son environnement et assurer une grande mobilité verticale. L’initiative des collaborateurs, et leur participation aux prises de décision, pourra permettre la motivation et donc le profit.
William Ouchi, professeur américain à l’université d’UCLA s’est intéressé aux entreprises japonaises et à leurs spécificités, par rapport aux entreprises américaines. Il est à l’origine de la « Théorie Z » et postule que la productivité des entreprises japonaises trouve son explication dans l’organisation sociale et les rapports humains. La prise de décision y est participative et le collectivisme est une valeur forte de l’entreprise. L’individu est inclus dans le groupe, ce qui renforce la responsabilité collective et le sentiment d’appartenance. L’entreprise « Z » s’apparente à un clan où tout le monde est focalisé sur un objectif commun. De là naît une véritable culture d’entreprise, entretenue dans des structures de progrès comme les cercles de qualité. Les docteurs Deming et Juran les ont mis en place après la guerre pour obtenir des progrès en utilisant le levier de la réflexion collective. Les employés sont regroupés par unité de travail et analysent les dysfonctionnements pour proposer des solutions concrètes. Ces cercles de qualité permettent le « kaizen », c’est à dire le progrès continu, en s’appuyant sur les ressources du groupe. On peut schématiser leur action de la manière suivante :
 Source : caseeworld.com
Source : caseeworld.comLes apports de Karl Weick
On ne peut évoquer ce courant sans parler des apports de Karl Weick. Professeur à l’université du Michigan, Weick s’intéresse, dans les années 70, au développement du groupe et à l’élaboration collective du sens au travail. Dans son ouvrage, The social psychology of organizing (1979), il précise la théorie du « sensemaking » qui désigne un processus continu d’élaboration du sens au travail. Pour lui, la dynamique organisationnelle est telle que des liens sont tissés entre les individus et un sens commun se dégage. Il résulte à la fois d’un processus de communication, d’un apprentissage lié à l’expérience et de la socialisation de ces expériences. On peut facilement l’illustrer par le cas de l’équipe de voltige de l’armée de l’air :
 Source : « Construire le sens par le retour d’expérience : le cas de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’air », Cécile Godé (Management et Avenir n° 41, 2011)
Source : « Construire le sens par le retour d’expérience : le cas de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’air », Cécile Godé (Management et Avenir n° 41, 2011)L’organisation est donc processuelle et se construit dans l’interaction des individus. Le management participatif trouve tout son sens dans cette analyse car il facilite la communication interpersonnelle. C’est bien la qualité des liens entre les individus qui fait l’organisation. Plus tard, en 1994, Smith et Katzenbach vont démontrer comment le groupe se métamorphose en équipe authentique.
 Source : http://www.emeraldinsight.com
Source : http://www.emeraldinsight.comC’est bien le management participatif qui permet cette « transformation » ; un simple groupe de travail n’est pas nécessairement voué à devenir une réelle équipe s’il ne remplit pas un certain nombre de conditions et ne partage pas certains éléments. Tout repose sur la confiance et la décision collégiale, ce qui entraîne naturellement la performance. La « valeur ajoutée » d’une équipe par rapport à un groupe est évidente et bien mise en avant dans le tableau suivant :
 Source : (From : Katzenbach, J. & Smith, D. (2004). The discipline of teams. In Harvard Business Review on Teams that Succeed, Harvard ; HBR Paperback, pp. 1-25)
Source : (From : Katzenbach, J. & Smith, D. (2004). The discipline of teams. In Harvard Business Review on Teams that Succeed, Harvard ; HBR Paperback, pp. 1-25)Ces différentes analyses et principes du management participatif redeviennent véritablement d’actualité, en période de crise même s’ils ont été longtemps critiqués.
1.2. Des critiques et des désillusions
Les approches, aussi séduisantes soient-elles, ont été très critiquées essentiellement à cause d’une mise en place manquée dans les entreprises.Les principales critiques
Les problèmes de groupe (symptômes du groupthink) affectent ces approches. Karl Weick a bien insisté là dessus en montrant qu’un « tissage trop étroit » des relations peut être fatal au processus organisationnel. Son analyse de la célèbre catastrophe de Mann Gulch le démontre. Il s’est intéressé aux conditions et situations qui ont pu bloquer le fonctionnement de l’équipe et conduire à la catastrophe. Lors d’un gigantesque incendie, les pompiers ont été confrontés à une situation nouvelle. Karl Weick précise ainsi que les dangers liés à l’incertitude ont conduit les membres de l’équipe à chercher leur survie individuelle au détriment de l’intérêt collectif (The collapse of sensemaking : the Mann Gulch disaster, administrative science quaterly, 1993). Car l’organisation se doit de trouver des solutions innovantes à des problèmes nouveaux, par construction collective pour éviter cet « effondrement du sens ».
L’aveuglement organisationnel peut aussi provoquer malentendus et incompréhensions. Plusieurs catastrophes l’ont démontré, comme l’accident de Tenerife en 1977 (collision de deux avions à cause de quiproquos de communication et d’une désorganisation du contrôle aérien) ou celui du tunnel du Mont-Blanc, en 1999 (non respect des procédures de contrôle et de sécurité). Le plus célèbre exemple est celui du crash en vol de la navette Challenger, en 1986. Au delà du débat technique, c’est bien la pensée de groupe des directeurs de tirs, prévenus d’un défaut potentiel, qui est à l’origine de l’accident. Alertés par quelques ingénieurs, sur la faiblesse d’un joint, ils ont estimé l’accident hautement improbable et procédé au tir. On peut parler d’aveuglement organisationnel. Ce phénomène a fait l’objet de plusieurs études, comme celle de du CNRS, L’aveuglement organisationnel ou comment lutter contre les malentendus (Broussard, Mercier, Tripier, CNRS, 2004). Les auteurs montrent que l’organisation est complexe et que chaque situation est « feuilletée », car les interprétations sont multiples et différentes suivant les groupes. L’organisation multidimensionnelle implique une approche souvent subjective des problématiques qui génère de multiples malentendus. Les obstacles à la coopération sont donc principalement cognitifs.
De plus, les résistances au changement ont souvent gêné la mise en place d’actions concrètes (cercles de qualité...). Michel Brossard a mis en avant, dès 1989, les causes de l’échec des cercles de qualité (Les limites du modèle-type de fonctionnement des cercles de qualité, Michel Brossard, Relations industrielles n° 3, 1989). Une des causes d’échec est le défaut d’intégration de ceux qui ont choisi de ne pas en faire partie, ce qui nuit à la mission première de ces cercles (recherche de la qualité par tous les protagonistes d’un processus). En étudiant les défauts de fonctionnement d’un cercle à moyen terme, il démontre le rôle joué par les non membres sur le contrôle du travail. Les cercles se montrent peu concluants, en dehors du Japon, leur action se limitant souvent au domaine technique, sans intégrer le client ni même les relations au sein de l’équipe. Françoise Chevalier étudie plusieurs cercles de qualité entre 1982 et 1989 et démontre leur relatif « essoufflement » (Cercles de qualité et changement organisationnel, Françoise Chevalier, Economica, 1999).
L’échec du management participatif
Dans les années 2000, certains auteurs n’ont pas hésité à prononcer un verdict d’échec à l’encontre de ces formes de management. Le plus connu est Norbert Alter (professeur de sociologie au CNAM) qui explique que le management participatif (groupes de résolution de problème, cercles de qualité) a généré ses propres dérives. La démarche de résolution des problèmes est trop lourde et ne résiste pas à l’incertitude. Elle est remplacée par de multiples « arrangements », véritables « structures clandestines », qui fonctionnent parallèlement au processus officiel de résolution des problèmes.
C’est bien la dynamique des cercles de qualité qui a pu poser problème. Ce sont les rapports hiérarchiques à l’intérieur des cercles qui se sont dégradés. Dans un contexte hiérarchique, les cadres se sont sentis dépossédés de leur influence et de leur expertise et ont « résisté » face à l’apport des cercles de qualité. Ainsi, confrontés à trop peu de coopération, des membres parfois déçus des résultats ont eu tendance à se démotiver et à délaisser les cercles de qualité.
Dans certaines entreprises, les cercles ont peu à peu disparu ou ils ont été intégrés aux services. On a parfois même parlé « d’effet de mode » des années 80, ce qui est injuste, car les cercles de qualité ont parfois été reproduits de manière « informelle » dans certaines entreprises, sans en porter le nom. Les espaces de réflexion ou de rencontre des « jeunes pousses », au début des années 2000, ont pu ainsi apporter de réels progrès managériaux, mais sans intéresser fortement la littérature spécialisée (même si de nombreux articles sont parus sur le « système Google » et ses espaces d’échanges).
Dans son livre Culture et comportement (Vuibert, 1992), le professeur Maurice Thévenet précise qu’on peut conclure que la plupart des échecs observés dans la mise en place des cercles de qualité ou la recherche de la qualité totale relèvent du au fait que l’amélioration de la qualité se fait selon une approche très « économique » sans tenir compte des logiques d’acteurs, de leurs compétences et de leurs représentations de la qualité. Ce ne sont pas les cercles qui sont en cause mais plutôt leur mise en place. D’autant plus qu’au Japon, ils se sont révélés très efficaces et pertinents. En occident, de nombreux facteurs ont rendu leur fonctionnement problématique, comme le manque de formation des animateurs ou le détournement par la direction de certains résultats. On a donc stigmatisé ces cercles et fustigé, un peu trop rapidement, le management participatif pour ses difficultés de mise en place.
2. Le management coopératif : une nouvelle approche, plus solidaire, du management
La persistance de la crise et la montée de l’individualisme dans le management ont remis au goût du jour la nécessité de travailler ensemble et de manière solidaire. Pour illustrer cette nécessité, il existe aujourd’hui un ministère chargé de l’économie sociale et solidaire (et de la consommation), piloté par Benoît Hamon. On attend aussi un projet de loi en 2013 qui permettra d’assurer le développement de ce pan de l’économie, en particulier des formes de sociétés coopératives et participatives.2.1. Des principes solides et nécessaires (pourquoi coopérer ?)
Le retour des théories humanistes
Le relatif échec du management participatif a pu être associé au développement des théories managériales plus « libérales », basées sur l’individu. Ainsi le « management par le stress », mis en exergue dans les années 90, a été l’objet de vives critiques, suite à une étude américaine, rapportée par Bernard Gazier en 2001 (Alternatives Economiques n° 188 - janvier 2001). Une équipe de chercheurs s’est penchée, entre 1995 et 1999, sur une quarantaine d’établissements industriels américains, dans trois branches aussi contrastées que possible : la métallurgie, la confection et l’imagerie médicale. Ils ont effectué des comparaisons de leur rentabilité et mesuré divers indicateurs de stress. Alors qu’ils s’attendaient à trouver une liaison positive entre les deux, le résultat est le contraire : les établissements les plus rentables sont ceux qui ont instauré un « système de travail à hautes performances », associant autonomie des travailleurs et management participatif et qui engendrent moins de stress que les autres (Manufacturing Advantage. Why High-Performance Work Systems Pay off, E. Appelbaum, T. Bailey, P. Berg et A. Kalleberg, Economic Policy Institute, ILR Press, CornellU. Press). Sans entrer dans l’étude des effets néfastes du management par le stress, l’actualité récente a démontré la détresse très forte des salariés face à certaines « méthodes » de management. Le postulat de l’individualisme croissant dans l’entreprise a été dénoncé par Gilles Lipovetsky (Métamorphoses de la culture libérale, Montréal, Liber, 2002), l’accomplissement pour soi (type sommet de la pyramide Maslow) est mis en exergue et la satisfaction « individualisée » à travers la performance chiffrée. Ainsi, le coût des risques psychosociaux a-t-il été estimé à 830 millions d’euros ! (Le stress, une méthode de management comme les autres ? 18/11/2012, www.libération.fr). De nombreuses « affaires » (suicides chez Renault et Orange, surveillance chez Ikea, délation chez Disney...) ont entrainé de nombreuses analyses sur le mal être en entreprise (en particulier celles de Christophe Desjours et de Marie-France Hirigoyen). Un courant « cinématographique » dénonce cette pression à travers des films clés des années 90 et 2000, comme Violence des échanges en milieu tempéré (J.M. Montout, 2003) ou Ressources humaines (L. Cantet, 1999). Plus récemment, La méthode (M. Pineyro, 2006) ou Fair play (L. Baillou, 2006) mettent en avant l’individualisme et le primat du pouvoir hiérarchique dans l’entreprise.
Les principes du management coopératif redeviennent d’actualité, comme la recherche du sens et du bonheur au travail. Annick Lainé propose de mettre en place le management coopératif pour prévenir les risques sociaux (Annick Lainé, ICA Research Conference, septembre 2010). Le management coopératif allie à la fois le Management (gestion des hommes et des opérations) et la Participation (partage conséquent entre les acteurs de l’entreprise dans les prises de décision, la transmission des compétences, la responsabilisation, l’autonomie...). Il s’agit donc d’une forme « moderne » du management participatif, car elle s’appuie sur les principes de la coopération. Dans une étude de 2000, Pichault et Nizet identifient cinq modèles de gestion des Ressources Humaines. Les deux derniers modèles font appel aux principes participatifs, mais avec des nuances. Le modèle conventionnaliste met en avant le management participatif et insiste sur la collégialité de la prise de décision, alors que le modèle valoriel est centré sur l’identification à une culture d’entreprise et repose sur une vraie coopération car aucun acteur n’est dominant (Pichault et Nizet, Les pratiques de GRH, Seuil, 2000).
Des principes solides
La coopération peut être approchée de deux manières, complémentaire et communautaire, ce qui fait que le travail coopératif est dual (Stéphanie Dameron, La dualité du travail coopératif, revue française de gestion, 2005). L’auteure démontre que ces deux approches s’entremêlent. Alors que dans un système de coopération complémentaire, des individus différents s’associent dans une logique de gain, la coopération communautaire rassemble des individus fortement ressemblants, avec une identité commune. Cependant, le projet est commun aux deux conceptions et ce n’est que la forme de rationalité qui les différencie (rationalité stratégique dans la première et identitaire dans la seconde). La même entreprise peut utiliser les deux, suivant l’évolution du marché, la dynamique de recrutement des collaborateurs (on peut démarrer avec des « missionnaires » et puis s’entourer ensuite de spécialistes qui adhèrent au projet). Cette analyse est intéressante car elle permet d’évacuer l’approche simpliste et préjugée qui consiste à ne voir dans les formes d’entreprises de l’économie sociale que des organisations de missionnaires. Les milliers de collaborateurs de FAGOR peuvent être des coopérateurs sans que cette coopération réponde à une motivation unique.
Le management coopératif s’appuie sur des principes essentiels, précisés par Jérôme Delacroix (Le management coopératif : un autre chemin vers la performance, Coopératique, 2006) :
- La circulation libre de l’information ;
- L’adoption de comportements basés sur la confiance et l’entraide ;
- La conjonction recherchée de l’intérêt de l’entreprise et celui de chaque salarié ;
- La mise en œuvre de moyens humains, technologiques et organisationnels pour atteindre ces objectifs.
Depuis longtemps, Joël de Rosnay propose sa vision du monde global et de la société en réseau (Le macroscope, 1975). Il y développe la notion de société "fluide”, traversée par de nombreux réseaux. Le management coopératif s’appuie donc principalement sur la notion de réseau et de mise en commun de ressources et d’énergies. Les systèmes de coopération technologiques font l’objet de nombreuses études, montrant leur puissance, comme celle de Howard Rheingold (Foules Intelligentes, titre original : SMART MOBS, M21 éditions, 2005).
Il s’agit, cependant, de redonner du sens au travail, ce que proposait déjà K. Weick (voir plus haut).
Le sensemaking, donner du sens au travail
Pour imposer le management coopératif, il faut rechercher « l’interaction respectueuse » (confiance, honnêteté et respect de soi), mais aussi la curiosité et la volonté de travailler ensemble. Karl Weick propose trois sources de sens : la culture, la stratégie et la structure. La culture va produire des repères, indispensables à la pérennisation du modèle, quand la stratégie va préciser les conditions de la contribution de chacun. Enfin, la structure va poser le cadre formel qui va codifier la coopération, comme par exemple le type d’entreprise (SCOP ou SCIC).
L’intelligence collective, de nouveau à l’ordre du jour
Sur la base du proverbe connu : « l’union fait la force », on peut mettre en avant les gains de la coopération, à travers le concept d’intelligence collective. Dans un documentaire poignant, Naomi Klein (Auteure du célèbre « No logo ») décortique le phénomène de résistance de salariés touchés par la crise en Argentine et leur combat collectif pour mettre en place un modèle autogéré (The take, 2004, http://www.thetake.org/). Certains salariés ont décidé de se fédérer pour relancer leurs entreprises pilotées selon un principe de démocratie directe. Trois ans après le documentaire, 1700 entreprises autogérées ont réussi à maintenir leur activité. On peut donc chercher à approfondir ce concept d’intelligence collective et son apport au management. L’intelligence collective désigne les capacités cognitives d’une communauté résultant des interactions multiples entre ses membres (ou agents). Des agents au comportement très simple peuvent ainsi accomplir des tâches apparemment très complexes grâce à un mécanisme fondamental appelé « effet de synergie ». Les conditions de réussite de ce modèle demeurent assez précises :
- L’existence d’une communauté d’intérêt, par exemple autour de l’entreprise ;
- La libre appartenance de ses membres, l’entrée est volontaire et la participation personnelle ;
- Une structure horizontale et des règles de gestion collective, les décisions stratégiques font l’objet d’un vote ;
- Un espace collaboratif et des outils de coopération, la communication se fait en réseau pour permettre l’interaction de tous les membres ;
- Un espace et des temps de partage pour faciliter et entretenir l’émergence d’une conscience commune.
 Source : http://www.emile2012.com/lintelligence-collective/
Source : http://www.emile2012.com/lintelligence-collective/Le management de l’intelligence collective n’est donc pas la négation de l’individu et de ses opinions, bien au contraire, c’est une construction d’un consensus au contenu forcément riche car partagé et généré grâce à la complémentarité et aux synergies.
Le travail coopératif, un nouveau modèle de management ?
En réaction contre la souffrance au travail (Desjours, Hirigoyen...), certaines organisations innovantes présentent un modèle collaboratif et humaniste. En 2010, le cabinet BPI a cherché à recenser ces pratiques. Le modèle « Google » est le plus connu, permettant à ses collaborateurs de consacrer 20 % de leur temps à des projets personnels avec les personnes de leur choix. Le cabinet présente également le cas d’une SCOP ardéchoise, Ardelaine, où les 25 coopérateurs sont sur un pied d’égalité salariale et tous polyvalents. A chaque exemple, le travail coopératif est mis en exergue et apparaît même comme un modèle managérial d’avenir. Un article intéressant de 2011 développe le concept de « démocratie d’entreprise », suite à une journée de réflexion sur les « manières alternatives de management » tenue à l’UNESCO le 17/11/11 (Qu’est-ce que la démocratie dans le monde de l’entreprise, Thibaud Brière, JDN sur http://www.journaldunet.com). En réaction à un management « autocratique », l’auteur présente les différentes formes que peut prendre cette démocratie d’entreprise. La plus connue est celle de l’actionnariat salarié, qui peut être un principe de base important dans des entreprises paternalistes comme AUCHAN (où les salariés détiennent environ 15 % du capital par l’intermédiaire de Valauchan, l’entreprise n’étant pas cotée en bourse). La participation constitue le dispositif juridique le plus connu, mais il est souvent « isolé » car uniquement financier, il faut aller au delà. C’est ce qui est fait dans le modèle de la coopérative, voire dans celui de l’entreprise autogérée, où le pouvoir s’exerce collectivement. Des formes plus poussées sont explorées par l’auteur, comme celle de « l’entreprise libérée », dans laquelle le bien commun des salariés est recherché. Un ouvrage récent (Liberté et Cie : quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises, Carney et Getz, Fayard, 2012) présente de manière provocatrice ces entreprises du « pourquoi » (celles qui donnent du sens) opposées aux entreprises du « comment », en affirmant que « la liberté, ça marche ! ». Ils développent largement le cas de l’entreprise FAVI (voir plus bas) dans laquelle le patron a supprimé les pointeuses pour que les salariés « travaillent pour faire des produits, pas des heures ». Ainsi, il convient d’explorer plus précisément le modèle coopératif et les cas de réussite de ce type de management.
2.2. Des réussites encourageantes (comment coopérer ?)
Les SCOP, longtemps marginalisées, font leur retour en affirmant la solidité de leur modèle et son caractère universel. A l’occasion de conflits sociaux récents et sur fond de vagues de licenciements, le modèle semble constituer la « dernière chance » pour maintenir l’activité lors des fermetures annoncées d’usines. L’affaire FRALIB, avec le projet de certains salariés de reprendre l’exploitation de la marque « Eléphant » d’Unilever, à partir d’une structure SCOP, ou bien l’affaire SEAFRANCE, dans laquelle un projet de SCOP a été développé pour sauver 500 emplois, ont rendu la SCOP « populaire », en temps de crise. Il s’agit donc d’en préciser les contours.Les principes coopératifs au centre des SCOP
Les coopératives sont définies par la loin du 10/09/1947 qui précise qu’elles ont pour objet de :
- Réduire au bénéfice de leurs membres, le prix de revient de certains produits/services ;
- Améliorer la qualité marchande des produits ;
- Contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu’à leur formation.
La loi du 19/07/1978 précise le statut de la SCOP, en le définissant : « Les sociétés coopératives ouvrières de production sont formées par des travailleurs associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu’ils gèrent directement... »(extrait de l’article 1 de la loi).
Contrairement aux entreprises classiques, il ne peut y avoir de conflits d’intérêt entre salariés et actionnaires puisque ce sont les mêmes personnes.
Le principe a fait l’objet de plusieurs recherches dont celle de Pasquet et Liarte (La société coopérative et participative : outil de gestion pour l’entrepreneur social ou nouvelle hypocrisie managériale ?, RIMHE, 2012). Ils précisent les zones de pouvoir dans ce type de structure :
 Source : Pasquet et Liarte, « La société coopérative et participative : outil de gestion pour l’entrepreneur social ou nouvelle hypocrisie managériale ? » RIMHE, 2012
Source : Pasquet et Liarte, « La société coopérative et participative : outil de gestion pour l’entrepreneur social ou nouvelle hypocrisie managériale ? » RIMHE, 2012SCOP et grande entreprise : les exemples de Chèque Déjeuner et Mondragon (MCC)
Le modèle de la SCOP redevient d’actualité mais pas seulement pour les petites structures. Deux grandes entreprises témoignent de la possibilité de croître durablement avec un modèle basé sur la confiance et la participation de tous : Mondragon en Espagne et Chèque Déjeuner en France.
Le groupe Chèque Déjeuner est le n° 3 mondial sur le marché des titres de services prépayés et le leader en France sur le marché de la gestion de l’Action Sociale. Il compte 2 000 collaborateurs dans 45 sociétés, à travers 13 pays et existe depuis 1964. Tous les quatre ans, l’ensemble des salariés-sociétaires élit les membres du Conseil d’Administration. Au nombre de neuf à quinze, ces derniers présentent librement leur candidature et force est de constater qu’ils proviennent tous de divers services de la coopérative (informatique, production, juridique, commercial...). Ce sont ensuite les administrateurs qui désignent par vote le futur Président-Directeur Général. Cet exécutif est relativement stable puisque seulement deux PDG se sont succédés depuis 1964. Cette entreprise est régulièrement citée comme modèle de management coopératif, ce qui ne l’empêche pas d’être rentable. Par contre, une grande partie des bénéfices est consacrée aux réserves financières et 45 % du résultat est reversé sous forme de primes aux salariés.
Quant au groupe MCC (plus connu sous le nom de Mondragon), il regroupe plus de 120 coopératives membres du groupe, dont six entreprises de services, 12 coopératives de recherche, 7 coopératives d’éducation, 4 entreprises agricoles, et surtout 87 entreprises industrielles dans tous les domaines : sous-traitance automobile, électroménager, fabricant d’ascenseurs, agro-alimentaire, filière bois, etc. les deux tiers des 35 000 associés travaillent dans le pays basque espagnol. Il s’agit d’un type unique au monde d’expérimentation de coopératives intégrées.
En octobre 1955, pour contourner les autorisations de création et d’implantation d’entreprises contrôlées par l’Etat, cinq jeunes fondateurs eurent l’idée de reprendre une entreprise en difficulté de produits électriques et mécaniques à usage domestique qui se trouvaient à Vitoria. C’est ainsi que naît la première entreprise coopérative ULGOR, du nom de la composition des initiales des fondateurs (Usatorre, Larranaga, Goronogoitia, Ormaechea, Ortubay), toujours en activité aujourd’hui sous le nom de FAGOR Electrodomesticos qui fabriquait à l’époque du petit matériel de chauffage. Le groupe ne cesse alors d’évoluer (40 coopératives en 1970) et se structure en développant de manière importante son propre système de formation. L’université de Mondragon compte aujourd’hui plus de 4 000 étudiants et alimente la recherche du groupe qui consacre 2 % de son CA à son financement.
Chez Mondragon, entre le bas de l’échelle et les dirigeants d’entreprises, l’écart des salaires est en moyenne de 1 à 4 et chaque salarié peut devenir « associé », moyennant deux ans d’ancienneté et une participation de 14 000 euros.
Chaque coopérative met en commun 2 % de son chiffre d’affaires à un fonds de solidarité. Il sert à accorder des liquidités aux coopératives les plus en difficulté. Par ailleurs, chaque coopérative constitue un fonds de réserve alimenté par 45 % des bénéfices quand il y en a, alors que le minimum légal est de 20 %.
Les coopératives sont les entités de base du groupe coopératif de Mondragon, elles sont libres de rejoindre ou de se séparer du groupe. Inversement, le groupe dans son ensemble accepte ou refuse de nouvelles coopératives en fonction de ses priorités de développement. En cas d’adhésion au groupe, les coopératives doivent se conformer aux règles communes. Dans toutes ces coopératives, l’Assemblée Générale représente la souveraineté de l’entreprise. Cette assemblée est convoquée au minimum une fois par an, ou exceptionnellement sur initiative de la direction ou de 10 % des membres-associés de la coopérative. Cette Assemblée Générale élit un Conseil recteur (assimilable à un Conseil d’administration) en charge de la gestion de l’entreprise, lequel nomme à son tour le Gérant. Deux organismes intermédiaires de contrôle et de dialogue entre les différents niveaux sont aussi élus par les coopérateurs :
- Un comité d’audit qui surveille l’application des décisions de l’Assemblée générale par le Conseil recteur ;
- Un conseil social qui assure un dialogue permanent entre les travailleurs de l’entreprise et la direction.
Cependant, le modèle coopératif n’explique pas, à lui seul, le renouveau du principe de coopération dans le management. D’autres expériences ont permis de le développer, la plus connue étant celle de la fonderie FAVI.
Des expériences coopératives poussées
Certaines entreprises sont allées beaucoup plus loin en réduisant la hiérarchie et en « libérant » leurs salariés.
. Le cas FAVI, l’entreprise sans chef
Selon Isaac Getz et Brian Carney (co-auteurs de Liberté et compagnie chez Fayard), certains dirigeants ont su « libérer » leurs entreprises. Le cas FAVI est emblématique d’abord grâce à son ancien direction, J.F. Zobrist, qui parcoure le monde pour donner des conférences et expliquer ce modèle. Dans une récente conférence à laquelle nous avons assisté (conférence organisée par le syndicat des formateurs-conseil au MOM de Paris, le 3/5/2013), nous avons été frappé par l’empathie et le caractère « humain » de J.F. Zobrist, qui a fait le tour le la salle avant la conférence pour demander à chaque auditeur de lui présenter son travail.
Le « cas FAVI » a fait l’objet de nombreux articles et est étudié dans les plus grandes écoles ; de nombreux visiteurs sont reçus chaque année dans la fonderie. Tout ce qui a été mis en place par J.F. Zobrist a été consigné par écrit pendant plusieurs années sous forme de « fiches » en accès libre sur le site de FAVI : http://www.favi.com/managf.php.
Une première série d’une soixantaine de fiches présente, par opposition aux préjugés managériaux classiques, ce qui a été mis en place. Par exemple : « la performance vient des ouvriers vs la performance vient de la structure » démontre qu’en supprimant tous les systèmes de contrôle générateurs de coûts et de non implication, J.F. Zobrist a redonné l’autonomie et le pouvoir de décision à ceux qui étaient les mieux placés pour le faire : les ouvriers.
Lors de son arrivée, dans les années 80, J.F. Zobrist, a passé plus de 4 mois à tourner dans les ateliers et à discuter avec les opérateurs pour essayer de comprendre avant d’agir. Il a ensuite pris des mesures drastiques qui ont transformé l’entreprise. Les principales sont :
- La suppression complète de toute la hiérarchie intermédiaire et la création d’un poste de leader qui coordonnera le travail de chaque mini-usine ;
- La structuration de l’entreprise autour d’une vingtaine de « mini-usine » dédiées à chaque client (les constructeurs automobiles). Elles sont entièrement autonomes, même au niveau budgétaire ;
- La croissance du budget formation (12 % du CA), centré sur le développement des compétences des ouvriers qui sont envoyés en stage au Japon ;
- La suppression des récompenses (car il considère que bien faire est « normal ») mais le développement des rémunérations collectives en cas de profit.
- L’Homme est bon (donc on n’a pas à dépenser de l’argent et de l’énergie à le surveiller) ;
- Il faut aimer son client (qui doit être le centre de toutes les attentions).
Dans un documentaire sur l’entreprise (question de confiance de François Maillart, 2009), le système est présenté en insistant sur la nécessaire confiance à accorder à « ceux qui savent » (les opérateurs) et à l’orientation-client donnée à la production. Les seuls contrôles qui ont été gardés le sont dans un but d’excellence (obtention des certifications avant les concurrents). Bien sur, ceux qui n’adhèrent pas au système ou regrettent l’ancien ne peuvent rester, et l’embauche devient un processus difficile car il faut vérifier que le futur salarié va partager les valeurs. D’autres entreprises ont appliqué avec bonheur cette « libération » ; de nombreux exemples sont présentés dans le livre de Getz et Carney (Liberté et compagnie), avec très souvent une remise à plat complète de la structure. C’est ce qu’a fait Chronoflex en France.
. Chronoflex, l’entreprise qui a tué l’organigramme
Cette entreprise moyenne, spécialiste du dépannage de flexibles hydrauliques sur engins de chantiers était très mal en point en 2012. Comme 160 de ses 210 salariés sont disséminés sur le terrain, elle a cherché à alléger la structure en transférant une grande partie des responsabilités à des « entités » régionales (15 au total). L’organigramme a été entièrement revu et est passé d’un « râteau » classique à un « double-cercle », autour des entités régionales.
 Source : Management, Janvier 2013
Source : Management, Janvier 2013Le regroupement des techniciens par région a été organisé dans une optique de réactivité aux demandes du client. En termes de management,, chaque équipe est entièrement autonome, coordonnées par un « capitaine » coopté (rémunéré 200 euros de plus par mois !).
Les managers ont aussi dû s’adapter (difficilement) en se reconvertissant ou en quittant l’entreprise. Ce qui est intéressant, c’est l’autonomie des équipes, qui décident de toutes les opérations concernant leur région. Chaque salarié est responsable du contrôle de ses opérations. Là encore, on peut véritablement parler de management de la coopération et de la confiance, indispensable à la réussite d’une telle entreprise. Pour prolonger la réflexion et envisager le développement, Chronoflex a créé des « groupes de réflexion » qui réfléchissent à des problématiques ou pistes de travail (le partage égalitaire des bénéfices par exemple). C’est donc surtout un environnement et une structure de travail qui ont facilité la coopération, donc la réussite (l’entreprise est bénéficiaire).
On peut donc se demander s’il existe différents « niveaux » de management coopératif. Dans un article récent, Thibaud Brière recherche les différentes formes de démocratie en entreprise (Qu’est-ce que la démocratie dans le monde de l’entreprise ?, Thibaud Brière, www.journaldunet.com, 16/12/11). Il en identifie six :
- L’autogestion, forme de démocratie directe appliquée à l’entreprise, avec exercice collectif du pouvoir. Cette forme est parfois décriée car elle renvoie à une acception politique et a pu produire quelques résultats décevants, dans les années 70.
- Les coopératives, qui cherchent d’abord à satisfaire les intérêts de leurs membres, nous y avons consacré quelques développements à travers le cas de la SCOP.
- La participation, étudiée dans la première partie de cet article et qui est trop souvent considérée uniquement comme un système de rémunération annexe, alors qu’elle est l’expression d’une gestion partagée voire durable.
- L’actionnariat salarié, qui permet aux salariés de devenir associés et de peser différemment sur la vie de leur entreprise. On peut prendre comme exemple le cas des salariés d’Auchan qui détiennent plus de 15 % du capital du groupe (le reste est détenu par la famille Mulliez) à travers leur fond de participation, VALAUCHAN. Il s’agit, selon Gérard Mulliez de « mieux réaliser encore le partage des fruits du travail et des apports de tous ».
- L’intra-entrepreneuriat, où les salariés deviennent de véritables associés, décisionnaires dans les différents niveaux de l’entreprise.
- L’entreprise libérée, pour laquelle il s’agit de réduire au maximum les contraintes qui gênent l’autonomie et la qualité du travail des opérateurs. Nous en avons présenté, plus haut, quelques cas emblématiques (FAVI, GORE, HARLEY...).
Conclusion : persévérer et convaincre
On a pu voir que le modèle de management coopératif n’est pas concentré uniquement dans le secteur coopératif et que l’économie « marchande » recèle des entreprises qui ont fait ce choix pour valoriser la confiance et l’autonomie dans leur système de management.Malheureusement, les mêmes « cas » d’entreprises sont constamment mis en avant et étudiés (FAVI, HARLEY, GORE), ce qui pourrait laisser penser que « l’exception confirme la règle », car l’organigramme en râteau est loin d’être mort. Une réflexion plus profonde, voire philosophique, peut nous conduire à chercher les valeurs et besoins qui émergent de ces modèles coopératifs. On pourrait alors faire le lien avec la recherche d’une gestion durable et le renouveau de l’engagement collectif.
Certains chercheurs qui travaillent sur la notion de « care », envisagent même son application dans l’entreprise. Il s’agit d’une forme d’attention portée aux autres, que l’on retrouve souvent dans le domaine médical ou social. Le « care » est une « théorie morale contextuelle » (et non un ensemble de règles) qui s’articule autour des « concepts de responsabilité et de liens humains ». C’est surtout une véritable éthique, une manière de prendre soin de ses collaborateurs et de revoir les relations de travail. Dans leur ouvrage Le souci des autres. Ethique et politique du care, Patricia Paperman et Sandra Laugier posent les bases de cette approche quasi-universelle. Lorsqu’on écoute J.F. Zobrist parler de FAVI ou les témoignages de créateurs de SCOP, on ressent ce souci de l’autre et cette attention qui amène la confiance. Moins militantes que le documentaire de Naomi Klein (The take) sur la reprise de leur entreprise par les salariés en Argentine, mais dans la même direction, ces expériences montrent qu’il existe une véritable alternative managériale au modèle classique de management, fondée sur la hiérarchie et basée sur les principes de Fayol et Taylor.
Bibliographie :
Sur la partie 1
Les nouvelles stratégies sociales des entreprises : les modes de gestion participatifs. Jacques ROJOT, Dalloz, 1995 The practice of management. Peter DRUCKER, 1954 The Social Psychology of Organizing. Karl WEICK, Mc Graw Hill Inc, New York, 1979 Sensemaking in Organizations. Karl WEICK, Sage Publications, Californie, 1995 The collapse of sensemaking : the Mann Gulch disaster. Karl WEICK. Administrative science quaterly, 1993 Direction participative par objectifs. Octave GELINIER, Paris, 1968 L’entreprise créatrice. Octave GELINIER, Paris, 1972 Théorie Z. William OUCHI, Paris, InterÉditions, 1982 Culture et comportement. Maurice THEVENET, Paris, Vuibert, 1992 Cercles de qualité et changement organisationnel. Françoise Chevalier, Economica, 1999Sur la partie 2
Ouvrage général :
Liberté et compagnie. Isaac GETZ et Brian M.CARNEY, Fayard, 2012Ouvrages complémentaires :
Manufacturing Advantage. Why High-Performance Work Systems Pay off, E. Appelbaum, T. Bailey, P. Berg et A. Kalleberg, Economic Policy Institute, ILR Press, CornellU Press, 2000 Le Macroscope : vers une vision globale. Joël de ROSNAY, Editions du Seuil, 1975 Surfer la vie : comment sur-vivre dans la société fluide. Joël de ROSNAY, Editions LLL, mai 2012 The take. Naomi KLEIN, 2004, http://www.thetake.org/Sur l’intelligence collective :
La Cinquième Discipline. Peter SENGE, First Editions, Paris, 1995 L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberespace. Pierre LEVY, La Découverte, Paris, 1997.Sur les SCOP :
L’énigme de Mondragon. Comprendre le sens de l’expérience. Jacques PRADES, revue [RECMA http://recma.org], n° 296, 2005 Les Scop, nous en sommes fiers ! François Kerfourn et Michel Porta Edité par le Club des anciens coopérateurs 2012 (42 témoignages d’anciens coopérateurs) Ceux qui aiment les lundis : travailler en Scop. Jean-Robert Dantou, Editions du Chêne, 2012 (40 tableaux photographiques de Scop) Les Scop au coeur de l’économie sociale. Roger Essel, Editions de Broca, 2012 Salarié sans patron ? Béatrice Poncin, Editions du Croquant, Coll. Idées coopératives, 2004Sur FAVI :
http://www.favi.com/managf.php (fiches téléchargeables sur le système FAVI)COMMENT UN PETIT PATRON NAÏF ET PARESSEUX INNOVE. 132 pages format de poche publié et vendu chez STRATEGIE & AVENIR/DIALOGIQUE, 4 Rue Joffre 57100 THIONVILLE, Tel : 03 82 88 26 00 La belle histoire de Favi - L’entreprise qui croit que l’Homme est bon, Tome 1 : Nos belles histoires, humanisme éditions, Paris La belle histoire de Favi : L’entreprise qui croit que l’Homme est bon, Tome 2 : Notre management et nos outils, Humanisme éditions, Paris
A propos du “care” :
Le souci des autres : Ethique et politique du care, Patricia PAPERMAN et Sandra LAUGIER, Editions de l’école des hautes études en sciences sociales, 2012Pour télécharger cet article au format pdf, cliquer sur le lien ci-dessous :
↧
More Pages to Explore .....
















